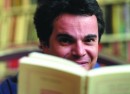L’un est directeur d’une Grande École, l’autre d’un lycée polyvalent, l’un est à Paris, l’autre en Bretagne, tout pourrait les opposer, et pourtant… Pascal Morand, au moment de l’interview directeur de l’ESCP-Europe, et Vincent Estève, proviseur de lycée à Lamballe (Côte d’Armor) se retrouvent, dans cet entretien, pour souhaiter une évolution rapide du système éducatif, un meilleur accompagnement des élèves, une plus forte autonomie des actions pédagogiques et surtout une plus grande ouverture sur le monde réel, de l’entreprise et de l’emploi.
La REVUE CIVIQUE : quelles sont vos attentes concernant le système éducatif français, compte tenu de vos expériences personnelles, bien différentes : l’une dans le secteur des Grandes Écoles, l’autre dans le secteur des lycées, à la fois de formation générale et professionnelle ?
Pascal MORAND : L’autonomie des Universités a permis un rapprochement de plus en plus fort entre le monde des Grandes Écoles et le monde des Universités. ESCP Europe est ainsi parti prenante d’un pôle de recherche de l’Enseignement Supérieur avec l’Université Paris I (Panthéon Sorbonne) et quatorze autres membres, dont l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), le CNAM, l’ENA, l’Institut du Patrimoine, etc. Ce rapprochement a été favorisé par le désir du précédent gouvernement de constituer des pôles universitaires forts. Même s’il y a toujours un débat sur les régions qui pourraient risquer de rester à l’écart.
Pour les jeunes aujourd’hui, ce n’est pas facile d’avoir 18-22 ans. Le contexte économique n’est plus ce qu’il était, et pas seulement à cause de la crise : il y a une forme d’instabilité structurelle. Il est beaucoup plus difficile qu’autrefois d’entreprendre une carrière linéaire, il y a nécessairement beaucoup de rebondissements dans une vie professionnelle. Le phénomène le plus important de la mondialisation est la fragmentation, l’éclatement de la chaîne de valeurs. Cela vient de l’ouverture des marchés mais surtout des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), les entreprises (industrielles ou de services) doivent se demander où produire pour rester compétitive. Cela crée un climat qui a été décrit par un certain nombre d’économistes comme instable et imprévisible. Mais c’est aussi un terrain d’opportunités, qui demande d’être habile et d’avoir confiance. Ce qui n’est pas le fort de notre pays et de notre jeunesse.
Vincent ESTÈVE : Pour ma part, je le vois en tant que chef d’établissement situé en Bretagne, il y a chez les jeunes Bretons une tendance au repli sur l’identité de la région. L’Académie de Rennes est une des meilleures dans les classements d’obtention du Baccalauréat mais nous avons une surqualification des jeunes. Ils occupent des emplois en décalage par rapport au niveau de diplôme obtenu, souvent avec le projet de rester au pays, en réaction à l’instabilité économique liée à la mondialisation.
Une difficulté à la mobilité
Mon analyse est qu’il faut dire aux jeunes que, quel que soit le niveau de formation, leurs parents et leurs grands-parents ont travaillé dans tous les coins de la France ! Demain, pour travailler, l’Europe sera le lieu d’emplois qu’il faudra exploiter. C’est pourquoi l’objectif, dans notre établissement, est d’ouvrir au maximum à l’international, avec des dispositifs de sections européennes, de partenariats étroits avec des établissements européens. Par exemple, nous sommes actuellement en projet de partenariat avec un établissement suédois, parce que nous avons des formations de maintenance de véhicules industrielles mais aussi parce que cela nous permet de développer les compétences linguistiques de nos élèves.
Cette dimension européenne vous réunit. Sur la mobilité ou l’absence de mobilité des Français, pensez-vous qu’il s’agit d’une des difficultés françaises ?
Pascal MORAND : Je mesure effectivement une difficulté à la mobilité française. Quand on est dans un environnement où il fait bon-vivre, on n’a pas nécessairement envie d’en partir et la France reste un pays où il fait bon-vivre… L’enjeu de la mobilité est qu’elle soit une mobilité volontaire et non pas subie. Les leviers de pédagogie pour développer la mobilité renvoient à tout ce qui peut donner lieu à une expérience internationale, à un ressenti international.
Vincent ESTÈVE : La mobilité se travaille tôt : la base est dans l’enseignement secondaire. C’est au lycée que l’ensemble des dispositifs doit être mis en place, par exemple avec des sections européennes qui ne soient plus limitées uniquement aux meilleurs élèves des filières scientifiques. Dans mon établissement, nous avons des Bacs pros sections européennes et, dans le cadre du programme Brigitte Sausay, 20 élèves de 2nde (sur 40 élèves pratiquant l’allemand) vont chaque année passer deux mois en Allemagne et suivent là bas une scolarité, les Allemands venant ensuite chez nous.
Le niveau de maîtrise des langues vivantes étrangères est une clé fondamentale pour la mobilité future. Il faut offrir aux élèves la possibilité d’approfondir leur maîtrise des langues. Dans les dispositifs de la réforme des lycées qui est en cours et qui concerne la mise en place de l’accompagnement personnalisé, nous avons fait le choix dans notre établissement de mettre les moyens sur le renforcement des niveaux en langues. C’est sur la base du volontariat (car nous nous adressons à des adolescents), dans un premier temps pour leur faire goûter et, au fur et à mesure, ils s’engagent souvent avec appétit dans le dispositif.
Les langues clé de la mobilité
Pascal MORAND : Je vous rejoins tout à fait sur l’importance des langues pour la mobilité et de l’anglais en premier lieu, même si tout le monde n’est pas tenu d’avoir une connaissance approfondie de l’anglais, il faut pouvoir se débrouiller dans cette langue. Les écoles de commerce se sont ouvertes très tôt à l’international. C’est particulièrement vrai à l’ESCP Europe qui a cinq campus à Paris, Berlin, Londres, Madrid et Turin. La question des langues ne se pose plus vraiment dans ce cursus. Cependant, il faudrait que les parcours internationaux soient généralisés aux autres écoles et universités.
Faut-il professionnaliser davantage les formations avant le Bac ? Et ne subissons-nous pas, en France, une forte dévalorisation des formations professionnelles ?
Vincent ESTÈVE : Dans mon établissement, nous formons aux métiers de la maintenance des matériels agricoles, des véhicules industriels, des engins de parcs et jardins, etc. L’an dernier, l’Académie de Rennes a diplômé 36 personnes au niveau Bac professionnel « maintenance des engins de travaux publics et de manutention » alors que la profession estime ses besoins à 2500 personnes dans les cinq ans qui viennent ! Très clairement, quels que soient les efforts faits, nous ne pourrons pas répondre aux besoins du marché du travail. Pendant ce temps, dans l’Académie de Rennes, 600 personnes ont eu un Bac secrétariat et n’ont aucune chance de s’insérer en Bretagne, à moins de prolonger leurs études. Pourquoi cette dichotomie ? Les jeunes et leurs parents n’entendent parler, dans les médias, que de la destruction de l’emploi industriel en France, sauf qu’en même temps tous les métiers de la maintenance industrielles, qui, eux, créent de l’emploi, ne trouvent pas de jeunes volontaires. Quand je propose à des jeunes d’entrer dans ces métiers-là, leurs parents leur disent (à tort) que ce ne sont pas des métiers d’avenir.
Mais il y a un problème d’âge, quant au choix à opérer. Les jeunes doivent choisir une orientation professionnelle à la fin du collège, quand ils ont environ 14 ans. Les élèves sont souvent trop jeunes quand ils se retrouvent face à ce choix décisif de la voie professionnelle qui est, en plus, clairement déconsidérée puisque c’est une voie qui est proposée uniquement après un parcours scolaire difficile. Ce sont ceux qui ont un parcours scolaire « déficient » qui se voient conseiller, par défaut, ces filières professionnelles même si elles correspondent à des métiers devenus très techniques. Il faudrait reculer l’âge du choix, en fin de classe de 3e c’est beaucoup trop tôt. Je pense que ce choix serait beaucoup plus judicieux à l’âge de 16 ans. Une adaptation de cette orientation charnière serait utile.
Les idées reçues sur les métiers
Pascal MORAND : Il y a, en France, beaucoup d’idées reçues sur les métiers, y compris quand on parle d’industrialisation ou de réindustrialisation. La réalité est que les métiers sont en mutation constante et dire qu’il y a des « secteurs perdants » et des « secteurs gagnants » tient du non-sens.
Quand les gens font mention d’industries ou de services, ils ne savent pas bien de quoi ils parlent parce que typiquement dans l’exemple de la maintenance, il s’agit bien d’un service, malgré la connotation industrielle du secteur servi. De plus, on sait qu’il y a des métiers de service qui sont aisément délocalisables, notamment tout ce qui donne lieu à un travail sur écran, y compris dans la recherche et le développement.
Je pense aussi qu’à 14 ans, c’est sans doute trop tôt pour se professionnaliser, sauf à considérer que l’on peut s’orienter très tôt dans un métier mais que cela n’empêche pas d’autres portes de s’ouvrir ensuite. Si, en Allemagne, il y a une professionnalisation de l’enseignement bien développée, c’est qu’on peut réussir une carrière tout en étant passé par les filières d’apprentissage et rejoindre, ensuite, des postes de direction. Il y a un a priori en France où filière d’apprentissage équivaut à métiers subalternes. Un travail de communication est à réaliser au niveau national, régional, voire local, pour revaloriser ces formations et expliquer que ces distinctions n’ont pas de sens aujourd’hui.
Mais comment revaloriser la formation professionnelle dans le système éducatif ?
Vincent ESTÈVE : Nous sommes en ce moment dans un débat autour de cette question de la formation professionnelle chez les jeunes : il y a eu, dernièrement, une réunion des présidents de régions ; ces derniers ont publiquement annoncé qu’ils souhaitaient, dans le cadre de la loi de décentralisation, prendre la compétence complète de la formation professionnelle. Jusqu’à présent, si la région finance 90 % des équipements et 100 % des locaux, l’État assure encore la rémunération des personnels enseignants.
En ce qui concerne les métiers qui font partie du cursus de mon établissement, très clairement, les entreprises nous demandent de prendre en charge les élèves pendant trois ans de formation, de 14 ans à 17 ans. Après cette formation initiale, nous avons développé avec les entreprises partenaires des formations « post-Bacs » professionnels, que ce soit dans le cadre de BTS, de licences professionnelles ou de certificats de qualification professionnelle. Nous avons construit un parcours dans lequel nous expliquons aux familles qu’il y a un temps pour la formation initiale puis pour la formation pratique, parce que les élèves sont encore jeunes et que ce n’est pas simple d’être dans une entreprise à 15 ans, ni pour l’entreprise d’accueillir un jeune. Notre modèle fonctionne aujourd’hui dans l’établissement avec une forte adhésion des entreprises. Les jeunes aussi perçoivent que le parcours proposé est progressif et cohérent.
Pascal MORAND : Si on prend le cas des métiers du secrétariat et de l’assistanat, je constate qu’il y a beaucoup de demandes, sûrement plus que d’offres d’emplois, mais c’est un métier qui a incroyablement changé. Aujourd’hui, les personnes qui recherchent une assistante ont besoin d’être épaulées par quelqu’un qui soit dans le contenu des actions menées et qui les aide face aux centaines de mails à trier. Cela demande une qualité de gestion des dossiers, une bonne expression orale et écrite, le métier n’est plus le même car le contexte a beaucoup changé.
Mais revenons au sujet de la méconnaissance et de la méfiance. Pour moi, quand la jeunesse perd confiance dans l’avenir, c’est mauvais signe. Un travail d’accompagnement est à réaliser. Il faudrait, en France, dire et reconnaître ce problème de confiance, au lieu de dénoncer la mondialisation et faire de l’Europe un des boucs émissaires favoris. Le monde est tel qu’il est mais c’est aussi un monde plein d’opportunités, où le talent et la diversité des talents comptent.
Ce n’est pas parce que l’on a des investissements en R&D (Recherche et Développement) et que l’on multiplie les brevets que, pour autant, les générations qui arrivent à l’âge adulte vont être en confiance et à l’aise dans leur travail. Personne n’est plus à l’abri et la solution de rester chez soi n’est évidemment pas la plus intelligente. Il y a des choses qui ne sont pas suffisamment dites ! S’il y a des spécificités à chaque pays, et s’il est vrai qu’on ne peut pas calquer ou importer un autre modèle à l’identique, on peut voir que les Scandinaves, sont très attentifs au suivi et à l’épanouissement des élèves et des personnes. C’est en s’ouvrant à d’autres expériences que le système français pourra progresser.
Il faut donc, selon vous, accompagner les jeunes dans leur parcours, c’est l’un des objectifs majeurs ?
Pascal MORAND : Oui, dans cette période difficile, il faut s’occuper des jeunes et faire écho à leurs attentes. Il y a une forte demande, de la part des jeunes, d’une nouvelle forme d’accompagnement pendant leurs études. Le monde a beaucoup changé, il change tout le temps, mais qui leur apprend cela ? Pour les parents c’est difficile : les familles se sont beaucoup éclatées et les parents sont parfois issus d’une génération qui a souffert de ce développement de l’instabilité. Dans les grandes écoles, il y a les professeurs, les étudiants mais aussi une troisième catégorie de personnes : les managers pédagogiques. Ce sont eux qui gèrent les programmes et qui s’occupent des étudiants, qui les accompagnent dans leur début de carrière, etc. Cet accompagnement manque dans les Universités, où il y a de très bons professeurs mais où il n’y a pas toujours de personnes disponibles pour accompagner les étudiants.
Dans les établissements supérieurs, il y a deux piliers à parité : la recherche et l’enseignement. Il y a eu, et il y a toujours, une focalisation sur la recherche. Dans tous les systèmes de notation des Écoles et des Universités (comme le Classement de Shanghai), la recherche est toujours au moins aussi importante que l’enseignement. En effet, elle est plus facilement mesurable… mais cette focalisation ne doit pas desservir l’enseignement. Il y a aussi le risque que l’établissement, lorsqu’il a le choix entre recruter des chercheurs ou des personnes qui s’occupent des élèves, favorise finalement les chercheurs, vu que son évaluation en dépend.
La légitimité de ceux qui accompagnent
Vincent ESTÈVE : Oui, l’accompagnement des jeunes est une autre clé de réussite. Pour les enseignants des lycées, le statut des personnels enseignants est totalement dépassé, il date de deux décrets du 25 mai 1950 qui n’ont pas été abrogés(1) ! Cela fait donc 62 ans que l’on a défini, dans un texte, les missions des personnels enseignants du second degré. Il y a eu plusieurs tentatives pour les faire évoluer, dont un qui a été de donner aux enseignants des temps de formation, avec aussi des temps d’accompagnement des élèves en plus. Je pense à un projet, qui a été testé dans les collèges expérimentaux où le statut des professeurs était le suivant : ce n’était plus 18 h de cours (pour les professeurs certifiés) mais 24 h, sous forme de 12 h de cours et 12 h d’accompagnement, de tutorat, de découverte des entreprises, etc. J’ai eu grande satisfaction des personnels enseignants de mon établissement même s’ils se réfugient derrière leur statut en disant qu’ils ne veulent pas que l’on touche « à leur 18 h », ils sont en fait largement au-delà de ces 18 h dans le fonctionnement réel.
Si on veut favoriser l’accompagnement des jeunes, qui sont entourés d’informations négatives (crise, suppression d’emplois,…), je pense que le statut des enseignants doit évoluer nettement. Cette question de l’accompagnement des jeunes doit être placée clairement dans les missions des personnels enseignants.
Pascal MORAND : La question est de savoir qui accompagne et avec quelle légitimité. Si les personnes prennent l’habitude d’accompagner, c’est bien, mais accompagner ce n’est pas seulement orienter. Et orienter peut même se faire sans accompagner, donc se faire à côté de la plaque. Quelle est la légitimité de ceux qui orientent ? Comment faire en sorte que les accompagnateurs comprennent ce qui se passe et saisissent le monde ambiant ? J’ai beaucoup de respect pour la recherche et l’enseignement de la pédagogie mais, à un moment, il faut aussi se mettre à la place des élèves de tous âges et voir ce qui peut leur être utile.
Avoir un discours critique sur le capitalisme et la morosité ambiante c’est bien, mais ce n’est pas cela qui apportera des solutions aux jeunes. La formation, telle qu’elle est dispensée pour les professeurs eux-mêmes, repose sur des compétences dans des domaines précis. Il faut donc que cela soit d’autres personnes qui assurent l’accompagnement, des personnes qui soient en position de bénéficier d’une formation permanente, pour être des capteurs de tendance et d’évolution. Sachant que les élèves perçoivent bien quand ils sont en face d’une personne à côté de la plaque alors que, quand ils sont bien guidés, ils savent être à l’écoute et sont même demandeurs !
Vincent ESTÈVE : Autre exemple d’adaptation nécessaire des textes. Aujourd’hui, il est extraordinaire que, dans le système éducatif, il n’est même pas prévu qu’une fois par an chaque élève de l’établissement ait un entretien avec un membre du personnel éducatif. Le système éducatif français ne s’intéresse aux élèves que quand il a un problème de comportement ou des difficultés. Certaines écoles, dont la mienne, pratiquent ces entretiens individuels mais ce n’est pas obligatoire. Cela devrait être généralisé.
Propos recueillis par Georges LEONARD
(In la Revue Civique n°9, Automne 2012)
Se procurer la revue
(1) Le statut des enseignants est défini par deux décrets du 25 mai 1950, ils définissent le service des personnels enseignants (18h de cours pour les certifiés et 15h de cours pour les agrégés). Les textes concernant les missions des enseignants vont se succéder jusqu’à arriver à la dernière circulaire du Ministère du 23 mai 1997.