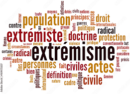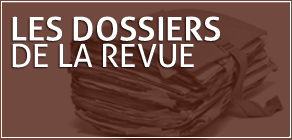Sous la direction de deux politologues de renom, Anne Muxel et Bruno Cautrès, respectivement directrice déléguée et chercheur du CEVIPOF (centre d’études de la vie politique française) de Sciences Po, l’ouvrage « Le vote sans issues » (PUG, Presses Universitaires de Grenoble) propose une analyse approfondie des résultats des élections législatives et européennes de 2024. À travers les contributions de 24 spécialistes des comportements électoraux et des institutions, ce livre met en perspective les dynamiques de campagne, les votes et leurs conséquences. A l’occasion de la parution de cet ouvrage de référence, qui permet de mieux comprendre cette période charnière de la vie politique française, Anne Muxel et Bruno Cautrès répondent aux questions de la Revue Civique.
–La Revue Civique : Suite à la dissolution de l’Assemblée nationale, les élections législatives de juin 2024 ont-elles abouti à une impasse politique complète et durable ou à l’apprentissage, difficile en France, d’une culture parlementaire du compromis ?
-Anne MUXEL et Bruno CAUTRES: C’est peut-être davantage les suites de la dissolution que la dissolution elle-même qui a abouti à une situation d’impasse politique. Aucun des trois vainqueurs potentiels des élections législatives ne gouverne en fait : ni le RN qui a gagné les deux tours en voix, ni le NFP qui a gagné le second tour en sièges, ni le front républicain qui s’est formé pour s’opposer au RN. Cette anomalie a créé une situation de blocage parlementaire et politique à laquelle s’ajoute l’impasse d’une tripartition où aucun des trois blocs ne peut à lui-seul obtenir une majorité des sièges à l’Assemblée.
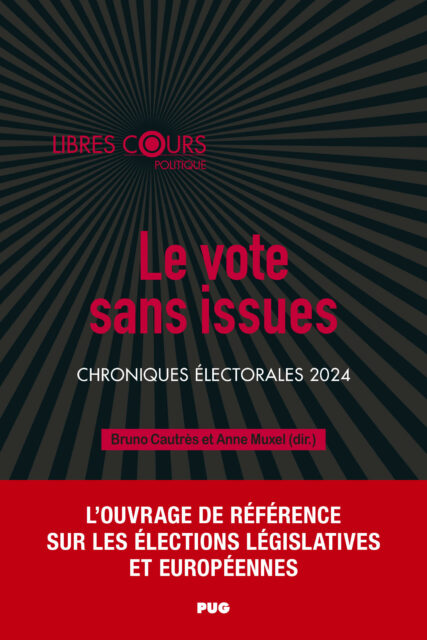
À bien des égards, cette situation inédite met à l’épreuve la culture politique française, il est vrai peu tournée vers la pratique du compromis parlementaire. La Cinquième République a été façonnée par une logique de verticalité du pouvoir présidentiel, où le Président dispose d’une majorité stable à l’Assemblée. Cette tradition présidentialiste a favorisé une conception « gouvernementale » du fonctionnement de l’Assemblée Nationale, plus que véritablement « parlementaire », dans laquelle le consensus est marginalisé. Dès lors, une Assemblée sans majorité et sans majorité claire représente une rupture culturelle autant qu’institutionnelle. L’idée même d’un compromis, qu’il s’agisse d’accords de coalition, de pactes de gouvernement, ou de négociations législatives, reste étrangère à une large part de la culture politique française.
Il convient néanmoins de nuancer l’idée selon laquelle la France serait culturellement incapable d’apprendre les logiques de compromis. D’une part, des précédents existent et notre culture politique ne se réduit pas à la Vème République dans sa version présidentialiste : dans de nombreuses collectivités territoriales ou au Sénat, des alliances qui transcendent les appartenances partisanes se construisent parfois sur des bases pragmatiques. D’autre part, si la France diffère institutionnellement de pays comme l’Allemagne ou les Pays-Bas — dotés d’un parlementarisme de coalition et d’une culture du compromis ancrée —, elle n’en est pas pour autant condamnée à ne pas évoluer. Il s’agit d’un apprentissage long, heurté, terriblement difficile mais pas impossible. Le vrai sujet est celui de l’élection présidentielle comme clef de voute du système politique français : si l’on souhaite que les partis trouvent des points de compromis à l’Assemblée, cela pose la question de la place et du rôle du programme sur lequel le chef de l’Etat est élu : simple base de discussion après son élection ? périmètre qui encadre cette discussion ?

« Une représentation proportionnelle ne réglerait aucunement ce problème (de majorité) puisque l’éclatement des forces serait encore plus important »
-L’instauration du scrutin proportionnel pour les législatives risque-t-elle d’accentuer l’émiettement de la représentation politique à l’Assemblée nationale et les difficultés à gouverner ou peut-elle favoriser en France, comme dans les démocraties européennes voisines, les pratiques de coalitions pluri-partisanes pour les gouvernements futurs ?
-Anne MUXEL et Bruno CAUTRES: La réforme du mode de scrutin dans un sens proportionnel est souvent perçue comme une amélioration de la justice et de l’équilibre de la représentation politique, deux vertus qui seraient mises à mal par le mode de scrutin majoritaire. Poser la question de cette manière est réducteur dans la mesure où un mode de scrutin doit remplir une double fonction : celle de représenter la diversité politique des électeurs au travers de celle des élus mais aussi celle de dégager une majorité pour gouverner si possible devant les mêmes électeurs. De manière évidente, la représentation proportionnelle privilégie la première fonction en s’efforçant de représenter de manière fidèle dans les assemblées la diversité des courants qui traversent l’électorat. En revanche, elle reflète souvent davantage les divisions multiples de l’électorat et ne parvient que rarement à dessiner devant les électeurs les différents traits d’un gouvernement de coalition.
Le mode de scrutin majoritaire permet souvent de dégager clairement une majorité de gouvernement au prix d’une certaine distorsion de la représentation des sensibilités politiques. Un problème grave se pose quand ce mode de scrutin ne remplit plus cette fonction. Tel est le cas depuis les élections législatives de 2024. Une représentation proportionnelle ne réglerait aucunement ce problème puisque l’éclatement des forces serait encore plus important et que l’absence de sens du compromis caractéristique de la culture politique française rendrait extrêmement complexe les négociations pour accoucher d’une majorité de gouvernement. Souvenons des négociations interminables de l’été dernier pour trouver un gouvernement plus ou moins viable ! Le maintien du majoritaire ne remplissant plus sa fonction, on pourrait peut-être envisager un scrutin mixte où la part de proportionnelle permettrait de recenser les familles politiques minoritaires significatives et la part de majoritaire permettrait de maintenir l’idée que les différentes options de majorités de gouvernement doivent être présentées aux électeurs et ne pas dépendre seulement, après l’élection, de la volonté des appareils politiques.
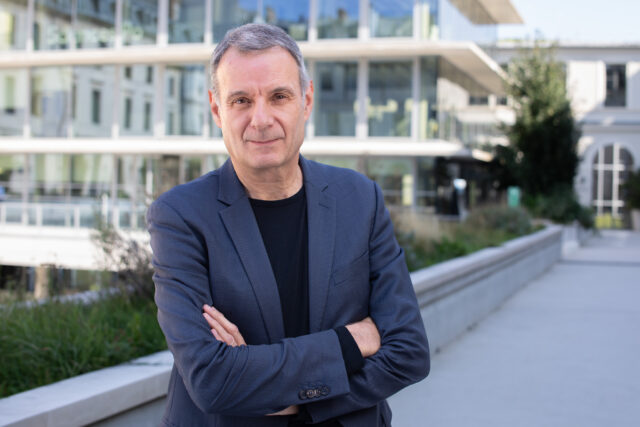
« Les acteurs politiques sont déjà tous dans la présidentielle de 2027 ou sa préparation«
-D’ici la prochaine présidentielle, le « vote sans issues » de 2024 à quels types de conséquences concernant le déroulement de la vie politique française ? Immobilisme avant « la mère des batailles » en 2027 ? Fin des habitudes antérieures de la Vème République, avec des majorités absolues et des oppositions absolues à l’Assemblée ?
-Anne MUXEL et Bruno CAUTRES: La situation politique est aujourd’hui tellement incertaine et confuse que la réponse doit être prudente sur cette difficile question. L’intensité de l’actualité internationale a, en partie, masqué un peu ces questions de fond. Il est néanmoins peu probable que notre vie politique connaisse d’importantes évolutions des lignes de clivages d’ici 2027. D’une certaine manière, les acteurs politiques sont déjà tous dans la présidentielle de 2027 ou sa préparation. De très importantes échéances intermédiaires auront de très importants effets tant sur la situation actuelle que sur la présidentielle de 2027 : congrès au PS et chez les LR, décision de la Cour d’appel concernant l’inéligibilité de Marine Le Pen en 2026, élections municipales de 2026, possibilité d’une nouvelle dissolution à partir de cet été.
Tous ces éléments ne vont pas dans le sens de faire bouger les lignes en termes de majorité à l’Assemblée. Les données budgétaires et l’équation douloureuse du budget 2026 vont rendre la situation encore plus délicate et confuse cet automne. Il n’est pas certain, face à des enjeux aussi clivants que nos déficits publics, l’immigration, le pouvoir d’achat, que la culture du compromis avance dans les mois qui arrivent. C’est de toute façon bien tard car Emmanuel Macron va arriver dans la dernière ligne droite de son second mandat et que tout le monde a déjà les yeux tournés vers 2027. La « vote sans issues » pourrait alors ne se dénouer que lors de la grande confrontation qui aura lieu dans moins de deux ans.
(14/05/2025)