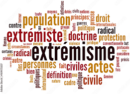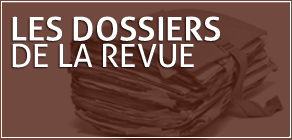Dans cet entretien pour la Revue civique, l’historien Marc Knobel analyse la vague antisémite qui frappe la France depuis 2023, l’impact du conflit israélo-palestinien sur la société française et le débat politique, ainsi que les risques d’instrumentalisation diplomatique de l’antisémitisme. Il revient sur les réponses institutionnelles, interroge la confusion fréquente entre engagement contre la haine antijuive et position diplomatique, et met en garde contre les amalgames qui menacent la clarté du débat public.
-La Revue Civique : Comment analysez-vous la démarche de Benjamin Netanyahu, qui relie la reconnaissance éventuelle de l’État palestinien par la France à la montée de l’antisémitisme sur le sol français ? Et que pensez-vous de la prise de position similaire exprimée publiquement par l’ambassadeur américain, accusant la France de nourrir le phénomène antisémite par son positionnement diplomatique ? Selon vous, ces démarches vous paraissent-elles légitimes ou présentent-elles au contraire un grave risque d’instrumentalisation politique et diplomatique de la lutte contre l’antisémitisme ?
-Marc KNOBEL : La lettre adressée par Benjamin Netanyahu à Emmanuel Macron frappe par le choix de ses mots, le moment retenu et la logique qu’elle manifeste. Qu’un Premier ministre israélien s’alarme de la montée de l’antisémitisme en Europe n’a rien d’étonnant : la flambée de violences, menaces et discours antijuifs, qui sévit en France depuis octobre 2023, est attestée par tous les indicateurs — 1 676 actes antisémites recensés en 2023, 1 570 en 2024, et encore 646 lors des seuls six premiers mois de 2025, certes une baisse de 27 % sur un an mais à un niveau qui demeure largement supérieur à la situation antérieure à la guerre de Gaza. Cette violence, presque ininterrompue depuis octobre 2000 — et pas seulement depuis le 7 octobre 2023 —, provoque chez nos compatriotes juifs un sentiment profond d’incompréhension, d’isolement et de souffrance. Elle nous oblige aussi à regarder en face le délitement de notre société. Cependant, il faut rappeler que la France n’est pas seule touchée : l’antisémitisme connaît aujourd’hui une inquiétante résurgence dans de nombreux pays, du Royaume-Uni aux États-Unis, de l’Allemagne aux pays scandinaves…

« Netanyahu franchit une limite », « il transforme une tragédie sociale et politique — l’antisémitisme — qu’il réduit à un attribut diplomatique »
Cependant, en associant explicitement ce sursaut de haine antisémite à la position diplomatique de la France sur la Palestine, Netanyahu franchit une limite décisive : il érige un choix de politique étrangère, la perspective d’une reconnaissance de l’État palestinien par la France, en cause directe de menaces qui pèsent sur les Juifs français. Or, cette logique n’est pas neutre. Elle transforme une tragédie sociale et politique — l’antisémitisme — en instrument de lutte diplomatique : l’antisémitisme n’est plus alors un phénomène à combattre en tant que tel, il devient un argument rhétorique destiné à délégitimer toute position discordante avec la ligne politique israélienne actuelle (Netanyahu et son gouvernement). En procédant à ce glissement, Netanyahu tend non seulement à disqualifier ses interlocuteurs, mais il réduit l’antisémitisme à un attribut diplomatique, ce qui revient à instrumentaliser un fléau qui exige, au contraire, la plus grande universalité et la plus stricte autonomie d’analyse.
Car, l’antisémitisme contemporain ne peut en effet être réduit à un simple produit diplomatique ou à une réaction mécanique face aux choix de politique étrangère. Ses sources sont multiples et s’inscrivent dans des dynamiques profondes : résurgence de préjugés anciens enracinés dans l’histoire européenne, diffusion de discours complotistes sur les réseaux sociaux, récupération idéologique par des mouvements politiques extrêmes, radicalisation d’une frange militante de la gauche radicale qui instrumentalise le conflit israélo-palestinien, mais aussi propagande islamiste, qui alimente et justifie des violences antijuives au nom d’une pseudo-solidarité avec la cause palestinienne.
Les propos de l’ambassadeur US « amalgament la politique étrangère d’un pays avec les responsabilité des violences antijuives qui y surviennent. Une telle ingérence me paraît inacceptable. »
Or, la stratégie de Benjamin Netanyahu a rapidement trouvé un écho dans la lettre rendue publique par l’ambassadeur américain Charles Kushner, qui — quelques jours seulement après l’initiative israélienne — a lui aussi mis en cause la France. Il a accusé le gouvernement de laxisme et soutenu que la volonté d’Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien « nourrissait » les actes antisémites sur le sol français. De telles prises de position dépassent la simple préoccupation légitime : elles amalgament la politique étrangère d’un pays avec la responsabilité des violences antijuives qui y surviennent, en occultant la diversité bien réelle des causes de l’antisémitisme contemporain. Une telle ingérence me paraît inacceptable.
Il importe donc de dénoncer, avec rigueur, cette confusion des plans. L’antisémitisme ne saurait devenir l’instrument d’une joute diplomatique, ni servir à disqualifier par avance tout choix politique qui ne coïnciderait pas avec la doctrine d’un gouvernement étranger. Demander à la France d’aligner aveuglément sa politique étrangère sur des injonctions extérieures, sous peine d’être désignée comme complice d’un climat de haine, c’est nier la souveraineté démocratique et empoisonner le débat républicain par un climat permanent de suspicion.
–Dans quelle mesure selon vous l’action présidentielle face à la recrudescence de l’antisémitisme en France, depuis 2023, se heurte-t-elle aux limites du débat public et aux mécanismes d’instrumentalisation politique ?
-Marc KNOBEL : Emmanuel Macron, depuis son accession à la présidence de la République, a multiplié les prises de position contre l’antisémitisme. Parmi les initiatives notables figurent le renforcement du cadre législatif relatif à la haine en ligne, des interventions publiques lors d’affaires ou d’agressions ayant profondément marqué l’opinion, l’extension de la définition officielle de l’antisémitisme—ce qui a permis de mieux appréhender les nouveaux visages de la haine—ainsi que son engagement constant en faveur de la Mémoire de la Shoah et de diverses actions pédagogiques. Ces avancées institutionnelles sont tangibles : les nier reviendrait à déformer la réalité des faits et à diminuer la qualité du débat républicain.

« Gravité de certaines agressions et profond sentiment d’insécurité au sein de la communauté juive »
Cependant, l’observation minutieuse de l’évolution politique et sociale depuis 2023 révèle à quel point l’ampleur et la violence inédites de la vague antisémite, exacerbées par le contexte du conflit entre Israël et le Hamas, ont mis à l’épreuve les réponses institutionnelles existantes. Non seulement le nombre d’actes recensés atteint des niveaux sans précédent depuis la création des dispositifs de signalement mais la gravité de certaines agressions, parfois d’une extrême brutalité, a profondément marqué la société française et nourri un profond sentiment d’insécurité au sein de la communauté juive.
Alors ? Le problème réside dans la capacité des autorités à anticiper ces chocs, à incarner une parole rassembleuse et à fédérer la société autour d’un refus commun de l’antisémitisme, alors même que le climat de tensions internationales complexifie la tâche du politique. Ces exigences, particulièrement décisives dans le contexte républicain, se sont avérées être de redoutables défis pour la parole présidentielle au cours des derniers mois. Les absences remarquées lors d’événements majeurs, tout comme la lenteur et la pudeur de certaines prises de parole officielles, illustrent les limites d’un appareil institutionnel confronté à l’ampleur du phénomène et à sa résonance internationale. Il ne s’agit donc pas tant d’un déficit de volonté que d’une confrontation avec les limites structurelles et contextuelles des réponses actuellement proposées.
Pour ma part, je ne suis ni le procureur, ni l’avocat d’Emmanuel Macron. Mon rôle n’est pas de juger les intentions du chef de l’État, ni de le défendre, mais de tenter en tant qu’historien de restituer une appréciation fondée sur des faits et une analyse raisonnée. La reconnaissance de ce qui a été accompli ne saurait étouffer les critiques légitimes mais ces dernières doivent s’appuyer sur des éléments avérés et non glisser vers le procès d’intention ou la mise en accusation est systématique. Or, force est de constater que le débat public a parfois franchi cette limite : certaines accusations, portées avec une virulence inédite, masquent la complexité du réel et alimentent un climat de soupçon généralisé.
Dans le même temps, il n’a pas manqué de voix pour déformer les constats, en affirmant que « le président ne fait rien », en contradiction avec les faits. De plus, il est arrivé que celles et ceux défendant une analyse nettement plus nuancée — à l’image du Grand Rabbin de France — soient momentanément pris pour cible, diffamés et insultés sur les réseaux sociaux ou dans un média prétendument communautaire (sur le Net) qui multiplie les saillies agressives. Là où la question de l’antisémitisme devrait rassembler, elle se trouve parfois instrumentalisée à des fins partisanes. Il appartient à l’historien de refuser cette dérive : l’analyse critique doit rester ancrée dans l’examen documenté des faits, loin des manipulations et des amalgames.
« La lutte contre l’antisémitisme s’est heurtée aux fractures d’un débat public trop souvent dévoyé »
En définitive, depuis 2023, l’action présidentielle contre l’antisémitisme a montré à la fois ses avancées et ses limites. Les mesures engagées sont réelles, mais l’ampleur du phénomène et la brutalité de son ancrage social les ont dépassées. Surtout, la lutte s’est heurtée aux fractures d’un débat public trop souvent dévoyé, où l’accusation prend le pas sur l’analyse et où le soupçon mine la confiance. Or, l’antisémitisme ne relève pas d’un camp politique : il concerne l’ensemble de la République. S’il doit être combattu avec la même énergie par le Président et les institutions, il appelle surtout une mobilisation de tous — partis, associations, école, société civile. Sans cette unité et cette clarté, nous continuerons à perdre un temps précieux en polémiques, au détriment du combat essentiel : éradiquer une haine qui ronge nos démocraties.
–Faut-il lier, dans l’analyse des responsabilités politiques, la position du Président Emmanuel Macron sur la question israélo-palestinienne et sa politique de lutte contre l’antisémitisme ? Et pourquoi le choix du moment pour reconnaître un État palestinien suscite-t-il autant de vifs débats ?
-Marc KNOBEL : Il est évident que les prises de position du Président de la République à l’égard de la politique de Benjamin Netanyahu et de la guerre à Gaza ont, elles aussi, suscité de vives critiques. Pourtant, il demeure essentiel de distinguer, d’un côté, son engagement contre l’antisémitisme en France et, de l’autre, ses positions sur le conflit israélo-palestinien. Confondre ces deux aspects ne peut qu’engendrer confusions et amalgames, nuisibles à la compréhension précise des enjeux liés à chacun de ces dossiers.
Rappeler cette méthode est primordial : ignorer cette distinction revient à brouiller le débat public, à alimenter des polémiques et à favoriser l’instrumentalisation politique. Sur le plan intellectuel, cela rend difficile l’évaluation de l’action menée contre l’antisémitisme. Sur le plan politique, cette confusion peut accroître la polarisation et fragiliser la cohésion du débat démocratique. Pour toutes ces raisons, il est indispensable, dans le contexte actuel, de traiter séparément la lutte contre l’antisémitisme et les positions internationales du Président afin de préserver la rigueur, la nuance et l’honnêteté du débat.
Cela n’empêche en rien, bien entendu, de porter un regard critique tant sur les choix du Président que sur ceux du Gouvernement israélien. Cette capacité à questionner les décisions reste au cœur de l’esprit démocratique : elle éclaire la diversité des analyses et constitue un rempart contre la pensée unique.
À titre personnel, tout en considérant la reconnaissance d’un État palestinien comme une étape nécessaire et comme la seule perspective plausible pour sortir d’un conflit interminable, il me semble que le « timing » de cette décision soulève des questions légitimes. De nombreux observateurs estiment en effet qu’une telle annonce, dans un contexte d’escalade militaire à Gaza et de tensions régionales extrêmes, risque d’être mal comprise ou récupérée, tant à l’international que sur la scène intérieure.

« Reconnaître un État palestinien sans conditions préalables risquerait de servir de relais à la propagande des terroristes du Hamas. Pour autant, des voix de plus en plus nombreuses rappellent l’extrême urgence d’une solution politique » concernant Gaza.
Choisir ce moment — alors que le conflit est à son paroxysme, sans ouverture réelle vers la négociation ou le cessez-le-feu — pourrait non seulement ne pas favoriser un règlement pacifique, mais aussi accentuer les polarités et encourager les surenchères. Reconnaître un État palestinien sans conditions préalables risquerait par ailleurs de servir de relais à la propagande des terroristes du Hamas, ce que redoutent de nombreux analystes. Pour autant, il faut rappeler que des voix, de plus en plus nombreuses, jugent cette prudence excessive : elles rappellent l’extrême urgence morale d’une solution politique, face à l’accumulation de victimes, à la détresse massive de la population civile palestinienne comme à l’angoisse des familles israéliennes dont les proches sont toujours retenus en otage. Pour elles, attendre encore reviendrait à prolonger une situation de souffrances et de blocage, rendant inacceptable la perpétuation du statu quo. Ce débat illustre, au fond, la tension entre lucidité politique, souci de l’efficacité et devoir d’humanité devant l’ampleur de la tragédie vécue de part et d’autre.
Reconnaître un État palestinien est, en soi, un choix fondé et nécessaire, je l’affirme ici. Mais une telle décision ne peut être isolée de son contexte : faite au mauvais moment, elle risque de nourrir les tensions plutôt que de les apaiser. Fait au bon moment, elle peut redonner une chance politique à deux peuples enfermés dans une tragédie sans issue. Entre urgence morale et lucidité stratégique, le défi pour la France est de tenir ce double fil. Sa crédibilité dépend moins de slogans que de sa capacité à conjuguer principe, efficacité et paix.
(01/09/2025)