
Michel Pinton a été le collaborateur de Robert Kennedy et de Valéry Giscard d’Estaing, et fondateur de l’UDF (confédération de partis qui réunissait, sous le septennat de VGE jusqu’aux années 90, les centristes et radicaux, les « républicains indépendants » et libéraux-sociaux). Auteur de plusieurs ouvrages de réflexions, il vient de publier un livre manifeste de « défense du bien commun ». Il y analyse 50 ans de vie politique et, selon lui, de « dérive vers le technocratisme et l’identitarisme qui nous ont mené à un ‘société sans objet’ « , en perte de repères et de lien civique. Il répond ici aux questions de La Revue Civique.
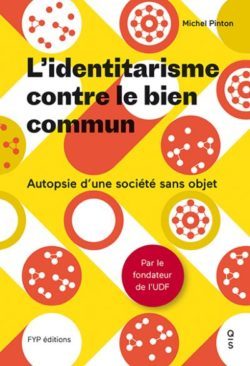
(FYP éditions)
-La Revue Civique : Dans votre livre, vous évoquez la notion de « Bien commun », mis à mal notamment par les dérives de l’individualisme, de libertés individuelles exacerbées, du « libéralisme avancé » selon la formule de l’ancien Président de la République, Valéry Giscard d’Estaing, dont vous avez été le très proche conseiller. Pouvez-vous nous dire ce qui vous semble essentiel dans ce concept de « Bien commun », et quelles sont à vos yeux les tendances – comportementales, sociétales, culturelles et/ou idéologiques – qui le menacent le plus aujourd’hui ?
-Michel PINTON : Si vous le voulez bien, prenons votre question autrement. Depuis la Révolution de 1789 jusque vers 1970, l’action publique en France a eu pour finalité l’intérêt général. Dans l’esprit des législateurs, il transcendait les intérêts particuliers et l’Etat en avait la responsabilité exclusive. L’autonomie donnée aux collectivités locales à partir de 1981 et la montée en puissance de l’Union européenne ont rongé ce principe, l’une « par en dessous », l’autre « par au dessus ». Il est devenu inopérant. La Commission de Bruxelles a alors imposé de le remplacer par un autre, appelé intérêt commun, qui consiste en une conciliation permanente, au coup par coup, entre des intérêts considérés tous comme particuliers, y compris ceux de l’Etat. C’est ainsi que nous sommes passés d’une société orientée vers une tâche collective unique – l’intérêt général – à une société sans but défini. Je l’appelle dans mon livre la société sans objet, reprenant une formule dont Giscard est l’inventeur.
De l’opposition entre principe d’intérêt commun et principe de bien commun
Ne croyez pas que ces concepts abstraits soient sans portée pratique. Ils ont au contraire, d’immenses conséquences politiques et sociales. Le principe d’intérêt commun, qui règne aujourd’hui sur toute l’Europe, engendre des comportements inédits dans l’histoire de notre continent. Ils sont loin d’être tous bénéfiques. Je m’efforce de montrer, dans trois chapitres successifs, comment la société sans objet est atteinte par des maux inconnus de nos ancêtres tels que la marginalisation, l’exclusion et les revendications identitaires.
Je ne crois pas que le principe d’intérêt commun puisse longtemps nous diriger. Il fait courir trop de risques à notre cohésion sociale et politique. J’ai essayé de placer mes réflexions et mes actions publiques, si modestes qu’elles soient, sous la lumière d’un autre principe : celui du bien commun.
Que faut-il entendre par ce terme ? Résumons sa définition en une phrase : selon lui, la solidarité politique et sociale est difficile voire impossible dans une société moderne, si l’autorité publique ne reconnaît pas que chaque être particulier –chaque nation, chaque communauté intermédiaire, chaque personne- a non seulement le droit d’exister, mais encore possède une valeur propre qui interdit d’en faire un outil du bien-être général et d’un intérêt catégoriel. C’est par les mots qui suivent le “mais” que le bien commun diffère de l’intérêt commun et le contredit. La simple conciliation entre intérêts concurrents aboutit toujours à sacrifier le faible au fort.
Appliquez ce principe aux travailleurs précaires, aux communes qu’on vide de leurs capacités d’action ou aux enfants nés de la GPA et vous aurez une aperçu de ce qu’il signifie pour la société sans objet. Il jette une lumière peu flatteuse sur toute l’action publique, du sommet européen jusqu’à sa base locale.

Le phénomène (des gilets jaunes) est durable parce qu’il exprime un malaise profond »
-Le mouvement social des « gilets jaunes » a fait apparaître une virulence inédite, dans les revendications et les protestations. Virulence et radicalités entremêlées, qui se sont accompagnées de violences, verbales et physiques. Des biens publics, comme des kiosques, des abris-bus, des vitrines, ont été saccagés. Comment interprétez-vous ce mouvement et ses dérives, qui semblent aux antipodes de l’esprit constructeur du « Bien commun » ? Que nous dit, selon vous, ces défiances radicales de la relation des Français aux institutions, à la vie publique ? Et pensez-vous le phénomène est conjoncturel ou durable ?
Il me paraît important de distinguer la cause du mouvement des gilets jaunes et ses effets.
Que demandaient les manifestants au début de leurs actions ? Des choses simples. Un travail qui soit suffisamment rémunéré pour habiter un logement décent, manger une nourriture correcte et fonder une famille stable; envoyer ses enfants dans des écoles qui dispensent un enseignement de qualité convenable; la possibilité de trouver un emploi pas trop loin de son domicile; des impôts et taxes qui n’écrasent pas aveuglément les plus vulnérables. Bref, ils demandaient que le gouvernement rende accessible à tous ce dont chacun –riche ou pauvre- a besoin pour mener une vie digne.
Ils s’inspiraient, sans le savoir, du principe du bien commun. Il n’échappe à personne que notre société sans objet a créé de grandes inégalités dans tous les domaines que je viens d’énumérer et que la France d’en haut a tendance, consciemment ou inconsciemment, à utiliser la France d’en bas comme un outil de son bien-être. A mes yeux, donc, le mouvement des gilets jaunes illustre de façon frappante, l’utilité du concept de bien commun. Il permet de comprendre la cause profonde de cette révolte inattendue et de discerner en quoi elle est justifiée. Il nous permet aussi de prédire que ce phénomène est durable parce qu’il exprime un malaise profond.
Que la révolte des gilets jaunes dérive parfois en violences et en abus de toutes sortes n’a rien de surprenant. Un mouvement populaire, quand il est spontané, est toujours menacé de débordements. Les pouvoirs publics ont le devoir de les réprimer. Mais il ne faut pas se laisser impressionner par l’écume au point de ne plus voir le courant profond.

La seule réforme qui compterait (sur le plan institutionnel) serait celle qui nous ramènerait à l’esprit (originel) de la Vème République »
-La culture politique française, très « verticale » et monarchique, qui a « fabriqué » la recherche d’« hommes providentiels » et le système de la Vème République, semble être l’une des causes du « mal démocratique » Français actuel. Les institutions traditionnelles sont défiées. Comment, selon vous, réformer le système politique français ? Par quels types de mesures, sachant aussi que les Français s’en prennent autant (et de toutes périodes) au chef de l’Etat qu’ils attendent quasiment tout de lui (et de l’Etat) ?
-Non, les institutions de la Vè République ne sont pas en cause. Elles ne sont pas à l’origine du « mal démocratique » dont souffrent les Français. Le problème est ailleurs. Pour en comprendre la nature, référons-nous, une fois encore, au principe du bien commun.
De Gaulle a établi une Constitution dans laquelle la mission de chacun des trois pouvoirs était clairement fixée. A l’exécutif revenait la responsabilité exclusive du bien commun de la nation. Les assemblées parlementaires représentaient les intérêts catégoriels. Le Conseil constitutionnel veillait à ce qu’aucun de ces deux pouvoirs n’empiète sur le domaine de l’autre.
Ce sage équilibre a malheureusement été rompu. Des politiciens de capacité médiocre ont choisi, par convenance partisane, la confusion des pouvoirs et la dilution des responsabilités du bien commun. D’abord, on a vu l’exécutif se soumettre au législatif –pensez à la cohabitation de Mitterrand avec Balladur ou à celle de Chirac avec Jospin- puis l’inverse, avec l’élection des députés dans le sillage de l’élection présidentielle. Sarkozy, Hollande puis Macron en ont profité pour établir une sorte de monarchie capricieuse. La verticalité dont vous parlez, c’est à dire, en fait, un déséquilibre des pouvoirs au détriment du législatif, n’est pas inscrite dans la Constitution. Elle est la conséquence de mauvaises pratiques.
La seule réforme qui compterait, à mes yeux, serait celle qui nous ramènerait à l’esprit de la Vè République. Vous verriez alors l’idée de bien commun reprendre toute sa force et la défiance des Français envers les institutions disparaître comme par enchantement.
Similitudes et différences (importantes) entre Valéry Giscard d’Estaing et Emmanuel Macron
-En 2017, au moment de l’élection de l’actuel chef de l’Etat, certains ont établi une comparaison entre Emmanuel Macron et Valéry Giscard d’Estaing, élu jeune Président en 1974. Vous qui avez été l’un des très proches collaborateurs de Giscard (et parmi les concepteurs-fondateurs de l’UDF), pensez-vous la comparaison pertinente ? En quoi se ressemblent-ils, et diffèrent-ils ?
-Il y a en effet des similitudes frappantes entre Giscard et Macron. Ils ont reçu la même formation intellectuelle à l’ENA. Ils ont fait l’apprentissage des affaires publiques dans le même corps de fonctionnaires, l’Inspection des finances. Ils ont accédé à la magistrature suprême en bousculant l’un et l’autre les appareils partisans de la droite et de la gauche. Ils ont tous deux commencé leurs mandats de Président avec l’auréole de la jeunesse et la promesse d’un changement radical. Plus frappant encore, le second suit le premier dans son programme « libéral, centriste et européen ». Le « nouveau monde » de Macron ressemble comme un jumeau à la « société libérale avancée » de Giscard.

Mais les deux Présidents diffèrent sur un point essentiel. Giscard avait une intuition politique ou, si vous préférez, un sens des réalités, dont Macron est dépourvu. En 1974, les trois piliers du programme giscardien étaient tout neufs et le Président pouvait croire à leur solidité. Pour autant, il a choisi d’avancer avec prudence. Les Français, même mal convaincus, lui ont fait confiance pendant sept ans ou presque. En 2017, ne pas discerner que ces trois piliers sont branlants, c’est de l’aveuglement. Macron semble ignorer que la fragilité d’un gouvernement centriste a été démontrée par l’échec final de son prédécesseur; il ne voit pas que les failles de l’idéologie libérale sont devenues béantes; il néglige les événements qui ont dévoilé les graves carences de l’aventure européenne. Loin d’être prudent, il a précipité les décisions doctrinaires. En guère plus qu’un an, il s’est heurté brutalement à la réalité.
« Emmanuel Macron a-t-il compris que l’exécution aveugle de son programme avait mené dans une impasse ? »
A-t-il compris maintenant , après deux ans d’exercice du pouvoir, que l’exécution aveugle de son programme l’avait mené dans une impasse? Quelles leçons tire-t-il de son impopularité persistante, des maigres avancées de son projet européen, de sa confiance excessive dans les « premiers de cordée », de sa difficulté à élargir sa base électorale ? Nous n’en savons encore rien. On voit bien que ses déconvenues des six derniers mois ont ébranlé ses certitudes. Mais jusqu’à présent, sa réflexion ne s’est traduite en aucun acte significatif.
-Et si vous aviez un principal conseil à adresser au Président de la République aujourd’hui, pour relancer son quinquennat et rehausser la confiance dans le pays, quel serait ce conseil ?
-Il serait tout simple : qu’il mette désormais toute sa pensée, toute son énergie et tous ses actes au service du bien commun de son peuple. C’est le seul moyen pour lui de regagner la confiance des Français.
Propos recueillis par Jean-Philippe MOINET
(avril 2019)











