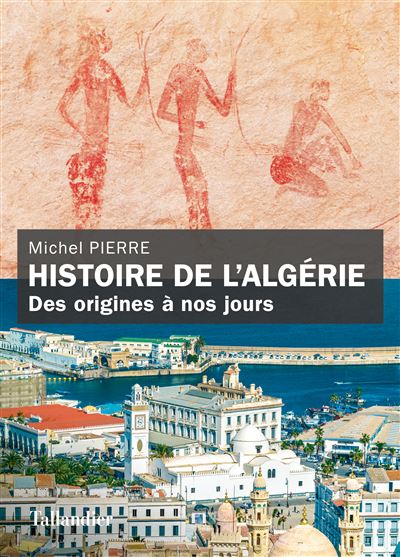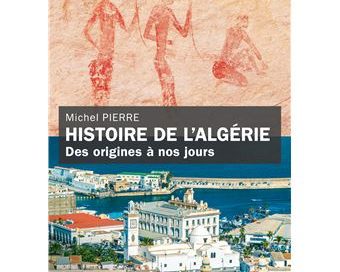
Michel Pierre vient de publier un ouvrage de référence, « Histoire de l’Algérie. Des origines à nos jours » (éd. Tallandier; 701 pages), qui retrace avec grande précision et rigueur une histoire singulière, riche et passionnante, allant de l’Antiquité à l’époque contemporaine. Ce grand connaisseur de l’Algérie, qui évite tous les écueils des raccourcis faciles et des approches idéologiques, répond ici aux questions de La Revue Civique.
-La Revue Civique : en introduction de votre livre, vous évoquez la nécessité de « s’y retrouver dans un passé aux multiples tissages » afin de « se prémunir d’enjeux contemporains pouvant mener aux falsifications si utiles au petit commerce des discours simplistes ». Pensez-vous que le temps est enfin venu d’évoquer l’Algérie sans tomber dans l’ornière des récits préfabriqués, enfermant les mémoires plurielles et fragmentés dans une vision partielle, parfois bloquée sur les tragiques fractures de la guerre d’indépendance ?
-Michel PIERRE : Ce serait bien que ce temps soit venu mais j’en doute souvent. Les exemples sont encore trop nombreux d’une méconnaissance réciproque des faits historiques, de convictions refusant de prendre en compte les complexités du réel, présent ou passé. Les fragments de mémoires l’emportent sur l’esprit de synthèse. Des deux cotés de la Méditerranée, il est simple de se réfugier dans des certitudes rassurantes ou des opinions mal étayées.
Pour nombre d’Algériens, à force de programmes scolaires, de monuments, de récits, de médias audiovisuels, la France n’a jamais eu qu’un projet génocidaire en Algérie et pour nombre de Français, l’Algérie doit beaucoup à la présence française. Sans négliger des maladresses, ainsi lorsqu’en septembre 2021 le Président Macron s’interroge sur l’existence d’une nation algérienne avant 1830. Il ne reste plus alors au Président Tebboune de mentionner 132 ans d’occupation durant lesquels « la France a commis des crimes à l’encontre du peuple algérien que les paroles ne sauraient occulter » et précise bien que cette occupation « a coûté à la France soixante-dix ans de guerre, de résistance et de révoltes dans toutes les régions du pays, car nous étions une nation ».

L’historien et anthropologue Omar Carlier avait souligné combien l’Algérie ne peut se défaire de ce passé car « il n’est guère de société contemporaine […] dont le destin ait été pareillement marqué par la colonisation et la décolonisation, dont l’être et le paraître doivent tant au poids de la guerre ». La France peut le faire maintenant plus aisément car, d’une part, la guerre ne s’est pas déroulé sur son territoire, le nombre de victimes n’est pas comparable et si l’exode des Européens d’Algérie a été un drame, il s’est finalement dissous dans la mémoire française chargée de bien d’autres évènements historiques. Rien de comparable pour l’Algérie dont la lutte de libération nationale est ontologique.
« Le moment n’est pas encore venu en Algérie d’aborder des sujets trop clivants même si d’incontestables évolutions ont eu lieu »
-On a l’impression que le travail historique et les publications qui en résultent sont d’une ampleur très différente en France et en Algérie. Le poids d’une histoire officielle, qui doit en Algérie absolument servir un « récit national » et les pouvoirs successifs, semble encore peser. Pensez-vous néanmoins qu’en Algérie l’ouverture à la variété et à l’indépendance des recherches historiques et surtout de leurs publications pourra progresser ?
-Il existe en Algérie des historiens de grand talent tel Daho Djerbal. La revue NAQD, qu’il dirige, revue d’études et de critique sociale, publiée à Alger existant depuis trente ans, est une source exceptionnelle de connaissances. Le problème, comme le dit Daho Djerbal lui-même dans un entretien récent, est qu’aucune bibliothèque d’Université, de wilaya (à l’exception de celle de Tipasa ), de commune ou Maison de la Culture n’est abonné à cette revue. Par contre, une centaine de centres de recherche dans le monde ont accès à NAQD par internet en français, anglais et arabe. On peut aussi mentionner les travaux du CRASC (Centre de Recherches en Anthropologie Sociale et Culturelle) à Oran avec des chercheurs comme Fouad Soufi ou Ouanassa Siari Tenghour. Sans oublier les travaux remarquables d’historiens et historiennes français d’origine algérienne telle Malika Rahal. On pourrait ajouter à cette liste, toujours en France, des journalistes à sensibilité historique, comme Slimane Zeghidour sans oublier, dans les deux pays, celles et ceux qui ont choisi la fiction pour rendre compte de l’Histoire.
Il n’en reste pas moins que la construction d’un récit national plus ou moins imposé en Algérie peut parfois peser sur certaines publications mais, même dans ce cadre, les travaux réalisés sont très utiles. Ainsi de l’ouvrage d’un jeune historien lié justement au CRASC, Idir Hachi qui a travaillé sur l’insurrection de 1871 et désigné comme l’un des membres de la commission mixte, coté algérien, issu du rapport Stora. Le choix des historiens algériens appartenant à cette commission est de fait intéressant mais aucun ne risquera d’aborder des sujets délicats pour l’unanimité du récit national d’autant que deux d’entre eux ont aussi eu des fonctions de haut-fonctionnaire, l’un comme directeur du Centre national du livre, l’autre comme directeur du Musée national du moudjahid. Je crains que le discours sur la repentance ne perdure mais je crois aussi que l’augmentation des travaux universitaires et la production de savoirs ne peut qu’être profitables au moins à long terme. Il faudrait aussi que l’université algérienne se penche plus vigoureusement sur certains aspects de l’histoire ancienne ou récente du pays, y compris sur des sujets polémiques encore soigneusement cloitrés dans les archives du pays. Le moment n’est pas encore venu en Algérie d’aborder des sujets trop clivants même si d’incontestables évolutions ont eu lieu.
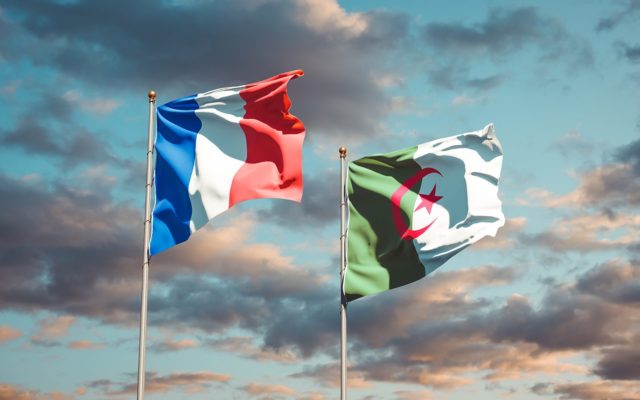
-On le sait, l’Algérie a été traversée et riche de courants culturels divers, dans son histoire ancienne et récente. Que ce soit pour la longue période ante-islamique ou pour les périodes récentes où plusieurs cultures, religieuses notamment, ont cohabité en Algérie, la diversité a fait partie intégrante de l’histoire de l’Algérie. Pourquoi cela a-t-il été longtemps occulté ? Et l’Algérie peut-elle retrouver le chemin d’une certaine diversité culturelle ?
-Au lendemain de l’indépendance et en réaction contre la période coloniale, l’Algérie a construit son récit national et son identité selon l’affirmation proclamée par Ben Badis en 1931 « l’Islam est ma religion, l’arabe est ma langue et l’Algérie est ma patrie ». L’arabo-islamisme a été l’idéologie dominante et exclusive pendant des années, elle l’est encore pour certains mais elle a du également composer avec les notions d’amazighité et de berbérité, qui ont peu à peu trouvé une reconnaissance officielle. La réforme constitutionnelle de 2016 a ainsi établi le Tamazight comme « langue officielle », l’arabe demeurant « langue nationale et officielle de l’État ». Par exemple, et c’était assez spectaculaire, le bus des joueurs ayant remporté la Coupe d’Afrique des Nations en 2019 portait des inscriptions dans les deux langues. Pour autant, il n’est pas question d’envisager un statut particulier pour la Kabylie et en brandir le drapeau dans des manifestations demeure punissable par la loi.
« La reconnaissance du passé continue (en Algérie) de se lire avec le prisme de l’indépendance et du nationalisme »
En dehors de cette évolution, la reconnaissance du passé continue de se lire avec le prisme de l’indépendance et du nationalisme. Ainsi le passé romain est évoqué par des figures de résistance et de rébellion , telles celles de Massinissa et de Jugurtha en un anachronisme total comparable à ce que la France du Second Empire et de la Troisième République avaient fait du personnage de Vercingétorix. Ironie de l’histoire, et on pourrait en faire une cérémonie commune en un même lieu, Jugurtha et Vercingétorix sont morts tous deux, l’un en 104 av. J.-C en , l’autre en 46 av. J.-C dans la même prison à Rome.
Il peut être aussi regrettable que ces siècles de romanité et de christianisation de l’Afrique du Nord soient si peu étudiés et valorisés. Il est vrai qu’il le furent beaucoup à la période française de l’Algérie pour des raisons touchant à la justification de la colonisation. Ceci expliquant cela, on le néglige aujourd’hui. Le rapport à la présence turque, à la Régence d’Alger est également intéressant à étudier dans une forme de renouveau d’intérêt qui n’est pas sans lien avec les efforts des actuelles autorités turques de renouer avec leurs anciennes zones d’influence.
Le plus préoccupant tient au faible intérêt des autorités locales ou nationales dans la préservation du patrimoine dans ses différentes strates. Le cas de la Casbah d’Alger en est un triste exemple mais c’est également valable pour d’innombrables sites romains ou autres. Malgré les efforts d’associations issues de la société civile, c’est l’indifférence, voir le saccage qui dominent. De plus, le goût de la diversité culturelle ne peut s’enraciner que par l’éducation, par la densité et le dynamisme de musées et de structures prenant le passé en compte, par l’enseignement des arts plastiques, la diversité des spectacles vivants, la présence de salles de cinéma, l’organisation de festivals etc. Or, ce n’est pas le cas.
-Malgré les efforts, et la visite d’Etat en 2022 du Président de la République Emmanuel Macron, des tensions et incompréhensions semblent persister entre l’Algérie et la France. Êtes-vous plutôt optimiste ou plutôt pessimiste quant aux possibilités de décrisper ces relations et de développer les échanges d’amitié entre les deux pays et les deux sociétés civiles ? Dans quels domaines, des avancées dans ces échanges vous semblent les plus faciles et prometteuses ?
-On pense à Camus qui imaginait Sisyphe heureux, il faut toujours remonter le rocher des incompréhensions pour le voir retomber régulièrement. Depuis soixante ans, les relations franco-algériennes sont passées par de multiples crises et moments d’accalmie.
Au lendemain de l’indépendance, on ne trouve pas en Algérie de demande de réparations ou de repentir vis-à-vis de la France. Le temps est à la coopération et l’effort de la France est conséquent. Le général de Gaulle souhaite une Algérie sur la voie du développement. En 1963, l’Algérie bénéficie d’une aide directe de plus d’un milliard de francs et la construction d’HLM prévue par le plan de Constantine est poursuivie. Par ailleurs, sur le plan de l’enseignement, on compte plus de 10 000 instituteurs venus de métropole, plus de 1 000 professeurs d’enseignement secondaire et 850 professeurs d’enseignement supérieur qui permettent à la jeune Nation algérienne d’assurer les premières rentrées scolaires et universitaires. De même, sur 100 000 fonctionnaires que compte l’administration algérienne, près de 14 000 sont Français au titre de la coopération.
« Pendant toutes ces années (1960-1970), tout semble évoluer presque banalement » vers une réconciliation franco-algérienne
Pendant toutes ces années également marquées par une coopération militaire non négligeable, tout semble évoluer presque banalement. Lors de la visite d’État du Président Giscard d’Estaing à Alger en 1975, le Président Boumédiène évoque « la page tournée » et la « lucidité » du général de Gaulle qui « ne pouvait nier sans se désavouer lui-même que notre combat brûlait de cette flamme qu’il communiqua en son temps à la France asservie ». Il reconnaît qu’après des « péripéties », il n’y a plus de « contentieux majeurs entre l’Algérie et la France » et que la coopération participe de l’écriture d’une page nouvelle entre les deux pays. Il y a certes des moments de crispation, ainsi lors de la nationalisation des ressources en hydrocarbures en 1971, lors des flambées de racisme anti-algérien à Marseille en 1973 ou à l’occasion du soutien implicite de la France en 1975 à Hassan II, à l’initiative de la « marche verte » qui permet au Maroc d’annexer l’ancienne possession espagnole du Sahara occidental.
L’arrivée au pouvoir du Président Chadli Bendjedid en 1979 après le décès de Boumédiène et l’élection de François Mitterrand s’inscrivent toujours dans processus d’apaisement. En novembre 1983, le Président algérien effectue la première visite officielle en France d’un chef d’État algérien. Interviewé par Le Monde avant son départ pour Paris, le Président algérien place la rencontre en comparaison avec la réconciliation franco-allemande et affirme que l’Algérie a « tourné la page pour en écrire une nouvelle ». Il n’est pas jusqu’aux harkis au sujet desquels il affirme que l’Algérie n’est pas « revancharde » et que leurs enfants, qui sont innocents des actes de leurs parents, « peuvent venir sans problème et nous les y encourageons ». C’est aussi l’occasion pour le Président algérien de tendre la main aux pieds-noirs pour qu’ils deviennent un trait d’union au lieu d’être un motif de discorde entre les deux pays.
Pour autant, le récit national algérien se construit de plus en plus sur la lutte de libération contre la France et sur les exactions de l’ancien colonisateur depuis 1830. À Alger est érigé en 1982, pour le 20e anniversaire de l’indépendance, le sanctuaire du Martyr, le Maqam Echahid et tout devient prétexte à une véhémence accrue contre l’ancien colonisateur. C’est ainsi qu’en mai 1985 la télévision algérienne accuse la France d’avoir utilisé des prisonniers comme cobayes lors du premier essai nucléaire de 1960. En l’occurrence, 150 d’entre eux auraient été ligotés à des poteaux à environ 1 km de l’impact de l’explosion afin de permettre aux scientifiques d’étudier les effets des radiations. L’information qui s’appuie sur des photographies représentant de simples mannequins recouverts d’uniformes divers est extravagante mais elle marque durablement l’opinion algérienne et perdure encore aujourd’hui. En décembre 1989, l’Algérie proteste contre l’émission par la France d’un timbre portant « Hommage aux harkis, soldats de la France ». Tout courrier posté vers l’Algérie avec ce timbre est renvoyé avec la mention « Non admis – Timbre poste présentant un caractère injurieux pour la République algérienne ».
Tout cela n’est que péripéties mais je me demande si d’autres évènements ne devraient pas être mieux pris en compte dans l’évolution du regard de la société algérienne vis-à-vis de la France, comme l’instauration des visas en 1986 ou le traitement de la première guerre du Golfe par la télévision française, reçue dans les foyers algériens majoritairement acquis à la cause irakienne et donc choqués par le parti-pris des émissions et des commentateurs français.

L’élection de Bouteflika, au printemps 1999, semble inaugurer une ère nouvelle. Il affirme son désir d’une « coopération purgée des relents empoisonnés du passé et fondée sur une réconciliation véritable entre nos deux peuples ». Ce qu’il réaffirme lors de sa visite d’État en France et de son discours à l’Assemblée Nationale. L’« Année de l’Algérie en France », en 2003, est le pic de ce processus de réconciliation que l’enthousiasme populaire à Alger et Oran lors de la visite d’État du Président Chirac illustre également. Une déclaration des deux Présidents le 2 mars évoque la « construction d’un avenir partagé », parle de « refondation et de restructuration des relations bilatérales au service de la paix, de la coopération et du développement ». Le texte se conclut sur la volonté commune d’élaborer et de finaliser un traité consacrant la volonté commune d’un partenariat d’exception.
« A chaque fois que la France a fait un acte en ce sens (de la repentance), il n’a jamais été considéré comme suffisant »
Signe d’une relation toujours au beau fixe, et malgré l’hostilité de soixante députés de sa propre majorité, Jacques Chirac convie pour le 15 août 2004 son homologue algérien, ainsi que seize autres chefs d’État, à célébrer le soixantième anniversaire du débarquement en Provence. À cette occasion, en un geste exceptionnel, le Président français attribue à la ville d’Alger la Croix de la Légion d’honneur en tant que « capitale de la France combattante »
Un nouveau geste symboliquement fort est réalisé l’année suivante en Algérie même. Le 27 février 2005, l’ambassadeur de France, Hubert Colin de Verdière, se rend à l’Université de Sétif à l’occasion de la signature d’un partenariat entre l’Université Ferhat-Abbas de la ville et l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand. Dans son discours , il rend hommage à Ferhat Abbas, évoque ensuite « la tragédie qui a particulièrement endeuillé votre région. Je veux parler des massacres du 8 mai 1945, il y aura bientôt soixante ans : une tragédie inexcusable. Fallait-il, hélas qu’il y ait sur cette terre un abîme d’incompréhension entre les communautés pour que se produise cet enchaînement d’un climat de peur, de manifestations et de leur répression, d’assassinats et de massacres ? » À la suite de ce discours, l’ambassadeur dépose une gerbe de fleurs devant la plaque commémorant la mort du jeune scout nationaliste, Bouzid Saâl , tué lors des manifestations.
On pouvait penser que ces gestes forts ouvraient la voie à un apaisement de la guerre des mémoires. Il n’en a rien été puisque quelques semaines plus tard, toujours à Sétif pour la commémoration du 8 mai 1945, le Président Bouteflika ne prolonge pas la démarche de l’ambassadeur de France mais choisit de dénoncer la répression française en comparant un four à chaux utilisé pour incinérer les corps des victimes « aux fours crématoires des nazis ». Il pourfend l’occupation qui « a foulé la dignité humaine et commis l’innommable à l’encontre des droits humains fondamentaux […] et adopté la voie de l’extermination et du génocide qui s’est inlassablement répétée pendant son règne funeste ». Il demande « un geste probant […] qui libèrerait la conscience française des cauchemars de la longue nuit coloniale et effacerait ainsi cette tache noire »
Jamais, la demande de repentance n’avait jamais été aussi clairement exprimée. Au sommet Euromed du 3 décembre 2005, Jacques Chirac évoque encore son souhait de pouvoir sceller la réconciliation avec l’Algérie par la signature d’un traité avant la fin de l’année, mais l’élan est brisé. L’Algérie reprend le fil de l’ancien clivage, l’association des anciens moudjahidines estime « qu’en l’état actuel des choses et compte tenu de l’obstination de la France à refuser de faire acte de repentance, l’Algérie ne doit pas signer un traité d’amitié avec elle ». En juillet 2006, le Président algérien revient de nouveau sur la colonisation française définie comme « l’une des plus barbares de l’Histoire », dénonce ceux qui ont imposé « leur emblème tricolore, leur chant patriotique et leurs ancêtres les Gaulois » et exige de nouveau des excuses publiques en estimant que ce serait la moindre des choses.
D’autres gestes seront tentés par la suite, tel François Hollande qui, devant le Parlement algérien le 20 décembre 2012, déclare que pendant cent trente-deux ans « l’Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal. Je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien ». On peut aussi évoquer le candidat Emmanuel Macron déclarant lors d’un entretien à la télévision algérienne en février 2017, que la colonisation était « une crime contre l’humanité» . Propos non repris par la suite au grand dam de certains dirigeants algériens.
Dès lors, faut-il être optimiste ou pessimiste sur l’évolution des relations franco-algériennes ? J’imagine mal les autorités algériennes renoncer à leurs exigences symboliques mais je vois aussi mal comment y répondre puisque à chaque fois que la France a fait un acte en ce sens, il n’a jamais été considéré comme suffisant. Il est préoccupant de voir le long courant des échanges économiques et culturels subir le contre-coup de ce jeu de dupes, dont la fin de partie ne peut être sifflée que par la partie algérienne.
(24/05/23)
-Le livre de Michel Pierre, édité chez Tallandier, disponible par ce lien