
Daniella Pinkstein, écrivain, a travaillé pour plusieurs institutions européennes et culturelles, elle a reçu le Prix du London Jewish Book 2021. Elle est l’auteure de « Que cherchent-ils au Ciel tous ces aveugles ? » (éd MEO) et de « Jérusalem par une rosée de lumières » (éd Biblieurope). Voici le texte qu’elle a adressé à La Revue Civique, qui met en perspective l’attaque qui a frappé l’écrivain Salman Rushdie, le 12 août dernier dans l’Etat de New-York.
Le 12 août 1952, Staline ordonnait l’exécution de vingt-quatre poètes yiddish, après un simulacre de procès et plusieurs années de torture. Le 12 août au soir, entre les murs de la prison de Loubianka, le sacre de la « nuit des poètes assassinés » inaugurait d’interminables abîmes. La nation juive européenne qui avait été sur tout le continent décimée, massacrée dans la plus absolue barbarie, connaissait son dernier sursaut. Le monde yiddish russe, ce qui restait tout au moins de cette culture engloutie, au sommet encore de son talent, de son héroïsme aussi, dans une explosion de génie et d’humanisme s’éteignait dans cette nuit à jamais profonde du 12 août.
Pourtant dès 1948, la police secrète soviétique avait déjà arrêté des centaines d’artistes juifs : quatre-cent-trente et une personnes parmi les plus grandes figures de la littérature, de la poésie, de la peinture, et de la musique avaient déjà disparu dans le néant du jour au lendemain.
Mais il fallait surcharger la liste d’autres poètes ! Le 12 août 1952, Peretz Markish, David Hofstein, David Bergelson, Leib Kvitko, avec des rimes comme seule arme, fermaient une porte dès lors immuablement scellée derrière eux. Qu’est-ce qu’un Staline pouvait espérer de la mort de ces bardes ? Pourquoi ajouter cette décoration sanglante à ses trophées de chair déjà innombrables ?
L’écrivain pugnace, dans l’incommensurabilité de sa solitude, renouvelle l’inscription de l’homme dans l’histoire collective.
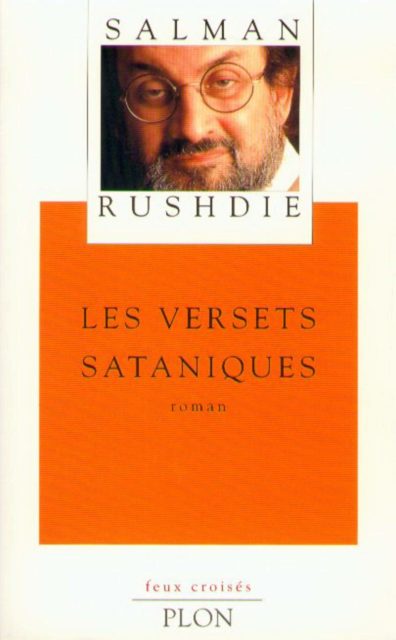
Quelques 16 ans plus tôt, Federico Garcia Lorca était assassiné en Espagne par les milices franquistes, dans un mois d’août décidément propice au meurtre des poètes.
Écrire relève, pour certains de ces bâtisseurs, de la tenue de ce monde, de sa dignité, chaque lettre portant son inexpugnable responsabilité. Écrire, pour certains écrivains, c’est posséder le monde entre le don et l’offrande, avec dans chaque main un rêve d’oiseau.
A partir des années 50, la littérature algérienne s’engouffre comme par effraction dans la littérature mondiale, les écrivains de génie se succèdent, – pour ceux qui écrivent en français, leur prose métamorphe le monde narratif dont la langue française est coutumière. Nedjma de Kateb Yacine en est l’un des exemples, amplifié par tremblements de terre, de langage, d’inventivités littéraires par Mouloud Mammeri, Mouloud Feraoun, Mohammed Dib, Rachid Mimouni, et tant d’autres encore.
L’écrivain pugnace, dans l’incommensurabilité de sa solitude, renouvelle l’inscription de l’homme dans l’histoire collective. Pas question de liberté d’expression dans ce lieu sombre, – formule incongrue des temps actuels, – mais du salut, aussi imperceptible soit-il, de la destinée humaine.
Dire que le poète risque sa vie ne dit rien, si l’on n’ajoute pas qu’il la risque pour d’autres que lui.
Il faudra tout le courage d’un perpétuel condamné à mort, Thomas Bernhard qui s’étouffe après chaque mot, pour que l’on puisse se regarder, nous, Européens d’après-guerre, pour que l’Autriche puisse reconnaître les ombres qu’elle doit désormais affronter. Il faudra l’immensité d’un W.G Sebald pour retrouver une phraséologie d’antan, langage d’un monde revisité, pour envisager le monde d’aujourd’hui sans y sombrer.
L’Europe comprend à une époque dite froide toute l’importance de l’homme qui se bat à mains nues ; les écrivains situés alors derrière le rideau de fer, dans la tour glacée des samizdats, sont pour quelques-uns aidés, publiés à l’Ouest, et deviendront même, pour deux d’entre eux, des Présidents d’une République qu’ils avaient espérée lettre à lettre.
L’Algérie est progressivement vidée de son intelligentsia
Et pourtant, à quelques coudées de cette époque, et plus encore de la nôtre qui se gausse à tout propos de liberté tout azimut parmi un agrégat d’individus qui se supportent sous le dénominatif du vivre-ensemble, toute une intelligentsia dont pourtant la France avait vanté et encouragé l’excellence est dans un silence étourdissant à son tour ravi au monde. On ne saura jamais si Mouloud Mammeri ouvrit la danse, si son accident en 1989 fut aussi accidentel que tant d’autres qui suivirent, la question dans l’éclat toujours vantard des crimes ne viendra qu’à partir de 1993. Le sacre des poètes assassinés reprenant sa faux. Cette année-là, l’un des plus grands écrivains, Tahar Djaout est assassiné à bout portant par deux jeunes qui l’attendent au bas de son escalier.
« Comment une jeunesse qui avait pour emblèmes Angela Davis, Kateb Yacine, Frantz Fanon, des peuples luttant pour leur liberté et pour un surcroît de beauté et de lumière, a-t-elle pu avoir pour héritière une jeunesse prenant pour idoles des prêcheurs illuminés éructant la vindicte et la haine, des idéologues de l’exclusion et de la mort ? » avait-il écrit en 1992.
Avec lui commence l’engloutissement de l’Algérie. « Jamais à ma connaissance, dira l’artiste Mustapha Benfodil, on n’a tué autant d’intellectuels en aussi peu de temps ». Le massacre est sans pitié. 1994, Ahmed Asselah, directeur de l’école des beaux-arts d’Alger et son fils unique, sont isolés dans une pièce de leur appartement, égorgés puis poignardés, Abdelkader Alloua, l’un des plus grands dramaturges, animateur pendant plus de 30 ans d’un théâtre en arabe populaire, adaptant également des pièces de Gogol ou de Gorki est assassiné, les morts s’enchaînent, sans relâche, Azzedine Medjoubi, Cheb Hasni, Matoub Lounès, … L’Algérie est progressivement vidée de son intelligentsia.
Kateb Yacine que l’on présentait au temps de sa renommée comme celui qui mettait à nu l’homme dans l’histoire du monde, et pour qui le français était le « butin de guerre », serait comblé d’aise de voir nos prétendus rebelles d’aujourd’hui s’émouvoir pour ceux qui l’ont honni, et qui formeraient de parfaits assassins de poètes. Les protocoles de sages de Sion donnant certainement plus de réponses à l’histoire dans une Algérie déchirée que Le dernier été de la raison[1], L’opium et le bâton[2], ou Nedjma[3], de la même façon que Malédiction ou De la barbarie en général et de l’intégrisme en particulier de Rachid Mimouni ne questionnent plus nos spécialistes autoproclamés du terrorisme.
Qu’avons-nous donc appris de l’histoire, et de ceux qui tentent de nous y réinscrire pour que le destin soit un choix ?

En 2019, The Independant écrivait sous la plume d’un Sean O’Grady :
« L’ouvrage infantile et imbécile de Rushdie devrait être banni par la législation actuelle pour incitation à la haine. Il ne vaut pas mieux qu’un graffiti sur un arrêt d’autobus. Je refuse du reste de le posséder chez moi, par respect pour le peuple musulman et mépris pour ce Rushdie. Je suis même plutôt enclin à le brûler en fait. Je suis dans un pays libre, après tout. »
Pendant qu’une poignée d’esseulés tient le monde, comme Atlas, sur de mortels épaules, d’autres se vautrent dans le crime ou la bêtise. Qu’avons-nous donc appris de l’histoire, et de ceux qui tentent de nous y réinscrire pour que le destin soit un choix ? Qu’avons-nous appris ?
Rien !
« Les écrivains sont de précieux alliés […] car ils connaissent d’ordinaire une foule de choses entre le ciel et la terre dont notre sagesse d’école n’a pas encore la moindre idée. Ils nous devancent beaucoup, nous autres hommes ordinaires, parce qu’ils puisent à des sources que nous n’avons pas encore explorées » énonçait Sigmund Freud. Tous n’appartiennent pas à cette extraordinaire catégorie, la veulerie de certains en sont, il arrive, la contradiction ; ceux-là du reste ne sont pas longtemps inquiétés, et continuent à être publiés au prix fort. Mais pour ceux, poignées d’individus qui persévèrent à leur corps défendant à enchanter le monde, en ombres ou par étincelles, ceux-là mêmes – qui sait – qui dans une cour d’école ou de collège, auraient aujourd’hui le doux privilège d’être insultés sous le vocable d’intellectuel, ces chercheurs d’absolu puisent en effet, sans ciller, à la source du monde.
Comme tant d’autres barbares avant lui, quel meilleur atout que de viser un poète ?
Ce 12 août 2022, Salman Rushdie a été poignardé au cours d’une conférence donnée sur la littérature. Le crime manque d’imagination disait un autre auteur, un certain Shakespeare. L’agresseur, cet envoyé inculte d’un pouvoir aveuglé par la destruction, comme tant d’autres avant lui, cet admirateur d’une idéologie religieuse mortifère, croyait sortir l’homme de sa destinée collective. Et en effet, comme tant d’autres barbares avant lui, quel meilleur atout que de viser un poète ?
Pour l’usurpateur du pouvoir, énonçait W. G Sebald, la seule rationalisation possible est de se l’approprier à des fins créatrices. Dans Le Château de Kafka continue-t-il, l’usurpateur est totalement incapable de la moindre forme de création, il est complètement stérile et s’épuise dans une perpétuation dénuée de toute raison. Il ne se maintient en vie que par l’identification des impuissants au principe de leur sujétion. « Ainsi le pouvoir immuable du château est-il moins absolu qu’il n’est le produit d’une symbiose parfaite que les opprimés ont réalisée depuis que l’expérience de l’impuissance est devenue pour eux une seconde peau [4] ».
Le réalisme magique, style narratif que Salman Rushdie va exemplifier, développer, – empruntant à ceux qui le précèdent et non des moindres, Rabelais, Laurence Sterne, mais aussi Nabokov, Gabriel Garcia Marquez, Borges, cette créativité langagière exceptionnelle -, rejoint la longue destinée humaine que la littérature fait croître sous les pas de ceux qui résistent et espèrent encore. Ceux pour qui l’expérience de l’impuissance ne sera ni chair, ni corps, ni tête pensante.
Il y a des littératures de l’urgence, de notre urgence collective. Il est étonnant de constater combien les dictateurs avides de plus de pouvoir, de sang, de cris, de glaires, les autocraties religieuses, les organisations terroristes, les subordonnés à l’ignorance les reconnaissent plus vite que nous.
Il serait souhaitable, enfin, de les distinguer avant la main des tueurs. De savoir aussi les honorer, avant que dans ce chahut de mots sans cesse plus creusés, abêtis, dévoyés, stériles, en circulation virale, tous les 12 août ne recouvrent, avec notre docile consentement, la surface de notre terre et l’espoir qu’elle charriait, à chaque jour naissant.
Daniella PINKSTEIN
(16/08/22)
[1] Tahar Djaout
[2] Mouloud Mammeri
[3] Kateb Yacine
[4] W.B Sebald, Amère Patrie.


Auteure aussi de « Jérusalem, par une rosée de lumières », préfacé par Rachel Ertel (Ed. Biblieurope), Daniella Pinkstein a reçu le prix de l‘European Jewish Writers in translation 2021 (décerné par le Jewish Book Week) et fut finaliste pour le 1er Prix du recueil de nouvelles de la Société des Gens de Lettres. Elle achève son troisième roman voué, une fois encore, à l’idée que l’on voudrait se faire « d’un monde réparé ».










