
Smaïn Laacher est Professeur de sociologie à l’université de Strasbourg. Il a été, de 1998 à 2014, Juge assesseur représentant le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à la Cour nationale du droit d’asile (Paris). Il est actuellement Président du Conseil scientifique de la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH). Auteur de nombreux ouvrages, il vient de publier « Ça me pèse. Obésité et corps embarrassant » (éd. L’aube, 2021) et « La France et ses démons identitaires » (éd. Hermann, 2021). Pour la Revue civique, il s’entretient ici avec l’historien Marc Knobel.
-La Revue Civique: Smaïn Laacher, vous êtes un sociologue de renom qui travaille et publie depuis de nombreuses années des réflexions, études, enquêtes et analyses engagées, pertinentes, sérieuses et de nombreux livres sur plusieurs sujets brûlants, notamment l’immigration et les mouvements migratoires, les sans-papiers, l’Algérie et le Maghreb… En mars 2021, vous publiez dans la collection « Questions sensibles [1] » aux éditions Hermann, un nouvel ouvrage au titre pour le moins alléchant : « La France et ses démons identitaires ». A un moment de grandes tensions, de grands questionnements, de débats passionnés de toutes sortes, d’engueulades intellectuelles, de confiance perdue dans les institutions et d’un ancrage de plus en plus prononcé du Rassemblement national dans notre pays, vous vous penchez sur les thèmes qui provoquent et suscites de nombreuses querelles et passions de toutes sortes : la colonisation, l’immigration, l’islam et les identités. Quelle est l’ambition de ce livre ?
-Smaïn LAACHER: Je suis sociologue. Ce qui produit chez moi beaucoup de curiosités et aussi quelques automatismes intellectuels qui apparaissent spontanément lorsque des phénomènes ou de situations suscitent de violentes polémiques ou des controverses sans fin. Je me demande toujours pourquoi il en est ainsi et pas autrement ; et je me dis aussi que si les gens disent ce qu’ils disent, ou font ce qu’ils font, c’est que sans aucun doute ils ont de bonnes raisons pour cela.

« Notre société est divisée en classes, certainement pas en « races ». Tous ces topos dans l’air du temps, d’une violence symbolique inouïe (et parfois physique)… possède un extraordinaire pouvoir magique : celui de nous faire disparaître la complexité du réel. »
A ce propos je tiens à dire que ce qui vient en premier lieu chez moi ce n’est jamais de la colère, ni non plus une remarquable tolérance (n’exagérons rien), mais tout simplement un désir irrépressible de savoir comment des mots, des pratiques, des conduites, des velléités de vaincre et donc d’avoir gain de cause, finissent par s’installer durablement sans alternative. Depuis quelques années le monde académique et, en dehors de lui, le monde social est fortement agité par des tempêtes que je qualifierais d’anthropologiques et culturelles, pour le dire rapidement. Ce ne sont même plus des questions de type « qui sommes-nous ? » ou « comment pouvons-nous penser et organiser la pluralité dans notre société », ou encore « comment articuler singularité et universalité » (celle-ci demeurant la référence majeure et ultime) sans négliger la lutte contre les inégalités et les discriminations.
Notre société est divisée en classes, certainement pas en « races ». Tous ces topos dans l’air du temps, d’une violence symbolique inouïe (et parfois physique), plus présents et plus portés par des syndicalistes, des militants, des politiques, des étudiants (infiniment plus souvent que les profs), à droite, à l’extrême droite, à gauche et à l’extrême gauche, tous ces topos disais-je donc, possède un extraordinaire pouvoir magique : celui de nous faire disparaître la complexité du réel.
J’entends par complexité : bien souvent l’impossibilité de déterminer avec le maximum de certitudes et de preuves irréfutables quelle est la variable déterminante : pour un emploi c’est la couleur de peau, le nom, le sexe, la compétence, etc. qui a été l’élément déterminant dans l’embauche ? Il est faux de dire que ce sont toutes ces variables qui se conjuguent et ont le même poids et sont perçus de façon identique dans toutes les circonstances. Mais peut-être est-ce, aussi, plus invisiblement, l’affinité structurale des habitus entre le candidat et le recruteur qui a fait pencher la balance en faveur du candidat ? Et donc l’ambition de ce livre c’est de rendre public mon point de vue sur ces débats étranges mais qui semble être des enjeux de vie ou de mort pour les uns et les autres.
–Dans votre livre, vous revenez constamment sur certaines envolées lyriques et surdramatisées qui portent sur l’identité nationale, l’identité du dominé, l’identité du « racisé », l’identité ethnique, la double culture, la double identité, etc. Que voulez-vous dire ?
-Bien entendu, le monde social et politique a changé depuis la fin des années 1970 et dans ce mouvement de transformation historique, deux processus se sont mis en place, funestes à leur manière. Le premier, c’est celui de mêler ou de confondre démarche rationnelle et défense de valeurs morales. Je devrais dire défense de valeurs identitaires, avec toutes ses variantes : « appropriation culturelle », « politique d’identité », « antiracisme politique », « racisation », « minorités non blanches », etc. Les meilleures intentions du monde ne suffisent pas, à elles seules, à redéfinir l’ordre des inégalités dans le sens d’une plus grande justice sociale.

« La logique mortifère de la confiance perdue dans les institutions, la parole d’État et de tous ceux qui se tiennent à l’écart du peuple et de ses malheurs, a produit des mondes clos, qui sont autant de « nous » à prétentions absolutistes ».
Le second processus a vu la croyance dans l’idéal démocratique s’effriter. La grande majorité des manifestations de ces dernières années, en particulier celles des « gilets jaunes », traduisent cette désaffection pour la démocratie et ses institutions telles qu’elles fonctionnent quotidiennement. La logique mortifère de cette confiance perdue dans les institutions, la parole d’État et de tous ceux qui se tiennent à l’écart du peuple et de ses malheurs, a produit des mondes clos, qui sont autant de « nous » à prétentions absolutistes.
L’appartenance religieuse, « culturelle » et l’origine nationale (ou la « race ») constituent la seule information à connaître et le premier repère à identifier pour régler ses actions de défense ou d’agression, pour choisir et décider des modalités tactiques ou stratégiques de ses alliances, pour indexer son taux d’indignation sur le degré de tort supposé subi par celles et ceux qui seraient liés, d’une manière ou une autre, à ces « cultures » et ces « confessions » supposées dominées.
Mon livre n’expose pas les résultats d’une nouvelle enquête. Son ambition est, pour la première fois en ce qui me concerne, d’intervenir aussi raisonnablement que possible dans le débat public sur des questions et des enjeux que je travaille et qui me travaillent depuis fort longtemps : ceux constitutifs du fait migratoire et de ses liens problématiques avec une série de thèmes majeurs que nous pouvons subsumer sous le concept d’identité. Et qui ne cessent de nous agiter depuis quelques années. Ne l’oublions pas : les grandes envolées lyriques sur l’ « identité », la « culture », la « mémoire », l’ « appartenance », le « racisme », etc., telles que nous les connaissons aujourd’hui, ont d’abord trouvé à s’exprimer à propos de l’immigration dans les années 1970 ; en particulier lorsque la société française à « découvert » l’immigration familiale ; c’est-à-dire des parents et leurs enfants, autrement dit des familles composites : étrangers et français pas naturellement français. Et c’est à propos de cette dernière catégorie de la population (« les enfants issus de l’immigration ») que les conflits interprétatifs se sont déployés avec un haut degré de misérabilisme ou de populisme.
–De la même manière, vous pointez du doigt celles et ceux qui affirment constamment -je vous cite- que « c’est la faute de l’Occident, de l’impérialisme, des « blancs », des racistes de gauche qui s’ignorent racistes, des racistes se prétendant antiracistes… »
-Si vous me le permettez, le début de ma réponse est indirect mais la précision a son importance. Nombreux sont les sujets sociaux et aussi des enjeux fondamentaux qui sont laissés aux puissants et à ceux qui savent, c’est-à-dire en réalité à des experts souvent liés aux puissances financières et aux appareils d’État ; les deux pouvant être les mêmes. Sujets sociaux et des enjeux fondamentaux qui ont, faut-il le rappeler, des effets directs et quotidiens sur notre vie personnelle, nos amours, notre conception du bonheur, notre santé, nos déplacements, nos formations, nos droits nos revenus, la qualité de notre travail, la qualité de nos protections sociales, etc.
Le droit, l’économie, la science, la technologie, la guerre, etc., sont autant d’instances qui jamais ne sont débattus par tous ceux et celles qui croient (c’est le mot le plus juste) posséder le monopole de la définition légitime de ce que chacun est et devrait être. Par exemple, si les mots hyper-techniques de l’économie et de leurs effets performatifs sur la vie des personnes et des groupes sont laissés à ceux qui savent, les mots, les expressions et les théories à petite portée qui jaillissent par dizaine à partir de cette notion centrale d’identité ne concernent quasiment jamais les conditions de reproduction de la structure des inégalités (qui, je le rappelle ne concerne pas seulement sa dimension matérielle mais aussi à tous les aspects touchant à la dignité des personnes) : « État raciste », « racistes », « antiracistes », « dominés», « Blancs », « blanchité », « privilèges blancs », « Noirs », «Arabes », « fascistes », « traîtres », « bountys » (« blanc dedans noir dehors »), « racisés », «néocolonisés », « indigènes », « victime», «intersectionalité », « cancel culture », etc.

J’arrête là cet inventaire à la Prévert. Chacun (notamment au sein des étudiants, militants, syndicalistes, etc.) peut sans grand effort réflexif se saisir à loisir de mots, d’expressions nouvelles, de verdicts et ainsi avoir le sentiment de contribuer à l’intelligibilité du monde et de ses malheurs ; avoir le sentiment unique et si précieux de démêler le vrai du faux et de distinguer sans risque d’erreur les bons des méchants. J’ai bien dit des « mots » pas de « concept » : le mot, pour parler comme les linguistiques, est le « plus petit élément pouvant être prononcé en isolation avec un contenu sémantique ou pragmatique ». Alors que le concept est une « faculté, une manière de se représenter une chose concrète ou abstraite » après que la chose concrète ou abstraite fut documentée (étude, enquête de terrain, etc.) Sentiment de puissance, il va sans dire, qui repose sur un ethos de dominant sensible à la condition ontologique du dominé, notamment lorsque ce dernier appartient à une « minorité » ou à la « diversité ».
« Une chose m’avait particulièrement frappée (dans mes recherches) : jamais, le propos antisémite ne surgissait seul, soudainement hors du cadre de la conversation ; il se manifestait toujours mêlé à la suite de longues plaintes sur l’injustice, la misère des uns et la richesse des autres, et surtout la cupidité des puissants qui, de surcroit, « détesteraient » les « Arabes », les « musulmans »… »
-Vous vous intéressez également à l’antisémitisme et ses modes, ainsi qu’à la relation supposée ou vérifiée entre immigration et antisémitisme, un sujet délicat. Pourquoi ?
-Je suis conscient qu’il est extrêmement difficile de tenir ce thème ou cet objet de réflexion dans les limites d’une rigueur scientifique attestée. Il est aléatoire et périlleux d’énoncer un certain nombre de faits objectifs, chiffres à l’appui, et d’en suggérer des analyses et des interprétations qui ne se laisseraient pas emporter dans la logique infernale et sans issue de la polémique. Les lecteurs jugeront de mon effort pour m’écarter de cette perspective sans issue.
Evaluer et mesurer l’antisémitisme a toujours été, en France et ailleurs, non seulement d’une particulière difficulté technique mais aussi source de nombreux débats. Je me suis risqué, dans ce livre, à aller au plus près des pratiques et des représentations et j’ai essayé de comprendre comment des personnes (français d’origine étrangère mais pas seulement) pouvaient être « saisies » par le préjuge antijuif ou le discours explicitement antisémite. J’ai essayé d’être aussi concret que possible en m’appuyant en grande partie sur mes enquêtes et sur les implicites qui débordaient de mes terrains de recherche en matière d’antisémitisme et de préjugé anti-juif.
Pour le dire simplement j’ai fréquemment rencontré, le plus souvent de manière périphérique, le thème du racisme, par exemple à l’encontre des Noirs dans les pays arabes, et celui de l’antisémitisme, pas seulement dans les pays « arabo-musulmans » mais aussi dans l’espace migratoire. Une chose m’avait particulièrement frappée et qui revenait toujours un peu de la même manière : jamais, le propos antisémite ne surgissait seul, soudainement hors du cadre de la conversation ; il se manifestait toujours mêlé et mélangé dans ou à la suite de longues plaintes sur l’injustice, la misère des uns et la richesse des autres, et surtout la cupidité des puissants (« les gens de là-haut ») qui, de surcroit, « détesteraient » les « Arabes », les « musulmans » et « s’entendent toujours entre eux (les juifs étant en bonne position si je puis dire) pour nous écraser ».
Systématiquement, la diatribe antisémite était liée au complotisme et au conspirationnisme : les figures incontestables et incontournables de « cette vérité qu’on nous cache » étant, bien entendu, les Etats-Unis, Israël et leurs alliés. Sans aucun doute pour comprendre les uns et les autres il m’a fallu m’appuyer sur une précieuse ressource, celle de ma familiarité intime des univers sociaux et des familles immigrées. Cette familiarité intime n’est pas seulement circonscrite aux enquêtes (entre autres sur l’institution scolaire) que j’ai menées auprès de nombreuses familles installées en France. Cette familiarité intime, je la possède aussi, pour des raisons historiques et autobiographiques évidentes, dans les trois pays du Maghreb et particulièrement en Algérie.
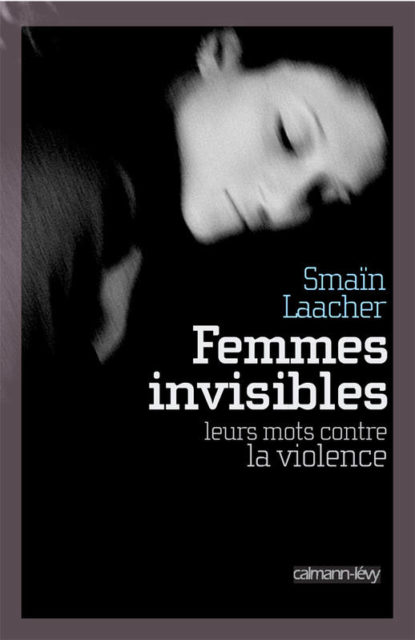
« Deux professeurs d’Université sont publiquement menacés après avoir été traités « d’islamophobe » et de « fasciste », avec l’appui ignoble d’un syndicat étudiant. Malheureusement ces débats sur les »identités », quelle que soit la forme sous lesquelles elles se présentent et sont présentées, ont toutes les chances de mener nulle part ».
–Au fond, ce ne sont plus les classes sociales, l’appartenance et la conscience de classe qui détermineraient selon vous aujourd’hui, les identités politiques. Mais, « les valeurs culturelles » et les « identités » nationales, religieuses et ethniques. La France est-elle malade de tous ces sujets ?
-Il ne vous a pas échappé qu’à ce sujet, ces dernières semaines, les débats ont été d’une grande violence et pas seulement symbolique ; je rappelle pour mémoire que deux professeurs d’Université sont publiquement menacés après avoir été traités « d’islamophobe » et de « fasciste », avec l’appui ignoble d’un syndicat étudiant. Malheureusement ces débats sur les identités, quelque soit la forme sous lesquelles elles se présentent et sont présentées, ont peu de chance de mener quelque part ; ou plutôt ont toutes les chances de mener nulle part.
C’est la connaissance, dans ce type de configuration, qui en prend un coup alors qu’il reste encore tant à connaitre. Les propriétés biographiques, celles attachées irréversiblement au corps et qui constituent des principes de division du monde social mais aussi des visions quasi anthropologiques du monde (beau-laid, grand-petit, cultivé-inculte, obèse-mince, pauvre-riche, blanc-noir, femme-homme, urbain-rural, instruit-analphabète, etc.), ne sont historiquement et sociologiquement intelligibles que recontextualisées à un moment donné dans une société donnée.
Ce qui est important, c’est d’avoir conscience des effets de théorie de la théorie qu’on ne manipule jamais innocemment. Il me semble que l’appartenance de classe (consciente ou inconsciente ou parfois consciente parfois inconsciente) est une variable fondamentale car, précisément, elle classe, elle distingue, elle oppose, elle distribue (entre les filières scolaires, entre les espaces résidentiels, etc.) en un mot elle détermine ou elle structure très puissamment le système d’expectation des individus et des groupes. Au sein d’un même groupe les divisions et les différences ou les oppositions peuvent apparaître non pas tant en fonction de la couleur de la peau ou de l’origine ethnique mais du rapport subjectif et objectif à la classe sociale.
Je voudrais enfin insister sur un point à mes yeux tout à fait fondamental : ce que l’on appelle la lutte entre les classes ne sont pas seulement des luttes pour la répartition des richesses matérielles. Les classes, et la sociologie l’a parfaitement montré, sont le produit d’un travail (politique, juridique, sociologique, symbolique, etc.) de construction et d’unification sur la base des proximités objectives dans l’espace social. Ou existe-t-il des groupes homogènes ? Nulle part dans aucune société… sauf dans la tête d’apprentis totalitaires.
Propos recueillis par Marc KNOBEL
[1] Cette collection « Questions sensibles » a été fondée et est dirigée par Céline Masson et Isabelle de Mecquenem.
(08/03/21)











