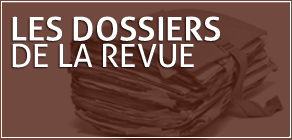Parmi les initiatives de Défense et résilience européenne, focus ici sur l’approche holistique de la sécurité promue par la présidence polonaise du Conseil de l’Union Européenne. Parmi les priorités soulignées par ce pays frontalier de l’Ukraine et de la Russie, le renforcement du « bouclier oriental », système d’infrastructures composé de fortifications militaires et de systèmes technologiques, destiné à bloquer une attaque potentielle de l’armée de Vladimir Poutine au-delà de l’Ukraine. Analyse pour la Revue Civique de Michaël Malherbe, le Secrétaire général du think tank « Atelier Europe » (présidé par Aymeric Bourdin).
Tous les six mois, les États-membres exercent à tour de rôle la fonction de présidence du Conseil de l’UE, une opportunité pour faire avancer leur propre vision. Face aux déstabilisations et à la multiplication des menaces hybrides, la Pologne dans son programme se donne pour slogan « Sécurité, Europe ! » afin d’illustrer ses priorités d’une « Union européenne (qui) doit se protéger elle-même et protéger ses citoyens » (…) C’est pourquoi la présidence polonaise soutiendra les activités visant à renforcer la sécurité européenne dans toutes ses dimensions : extérieure, intérieure, informationnelle, économique, énergétique, alimentaire et sanitaire ».
Outre les questions de Défense et Sécurité illustrée notamment par le soutien fort aux capacités de défense, la présidence polonaise s’attachera à promouvoir l’industrie et les infrastructures de défense, telles que le Bouclier oriental et la ligne de défense balte. Pour la chercheuse à l’IRIS Louise Souverbie, spécialisée sur les questions de défense européenne, l’une des priorités polonaises est de porter « le projet East Shield, un bouclier d’infrastructures composé de fortifications militaires et de systèmes technologiques tels que radars, systèmes anti-drones, etc. Varsovie souligne l’intérêt que présente ce projet pour l’ensemble de l’Union et souhaite donc pouvoir utiliser les instruments de l’UE pour le soutenir ».

Contrer les ingérences informationnelles : l’exemple suédois
De manière significative, la résistance aux ingérences étrangères et à la désinformation est également mentionnée parmi les priorités en termes de défense holistique, afin d’améliorer la capacité de l’UE à prévenir et atténuer les effets des actions hostiles dans le cyberespace. A ce titre, David Colon, enseignant et chercheur à Sciences Po publie dans la revue Défense Nationale un papier très intéressant sur la « La « défense psychologique » face aux manipulations de l’information » mentionnant notamment le modèle de l’Agence suédoise de défense psychologique, chargée de protéger « la société ouverte et démocratique et la libre formation d’opinions en identifiant, analysant et répondant aux influences inappropriées et autres informations trompeuses dirigées contre la Suède ou les intérêts suédois ». Cette initiative vise à renforcer l’immunité des Suédois face aux menaces informationnelles par une approche globale et horizontale impliquant l’ensemble de la société civile.
« Ses missions comprennent la sensibilisation à la menace informationnelle, le développement de méthodes et de technologies permettant d’identifier et de contrer les ingérences informationnelles, la formation des journalistes et des institutions, ainsi que le financement de recherches liées à la défense psychologique ». La conception suédoise de la défense psychologique repose ainsi sur quatre principes : la résilience, l’analyse de la menace, la dissuasion et la communication stratégique. La création de cette agence, dans le contexte de la détérioration de la situation en matière de sécurité globale, correspond à la réactivation d’un concept datant de la guerre froide, dont la Suède a été l’une des références, la « défense totale », qui repose sur la défense militaire, la défense civile, la défense psychologique et la défense économique.
Un Commissaire pour développer une union de la défense européenne
Du côté de la Commission européenne, le premier Commissaire à la Défense, Andrius Kubilius, deux fois ancien Premier ministre en Lituanie, se voit confier une priorité de la nouvelle mandature : « Il travaillera à développer une Union de la défense européenne et à renforcer nos investissements dans les capacités industrielles », selon la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen dans L’Express.
Le principal chantier porte sur la mise en œuvre de la Stratégie industrielle européenne de Défense adoptée le 5 mars 2024, en vue d’aboutir à une orientation commune de l’industrie de défense européenne pour transformer durablement la Base Industrielle et Technologique de Défense à travers l’achat d’équipements militaires de manière collaborative, la consécration de budgets spécifiques aux marchés publics européens et le renforcement des échanges commerciaux de défense intra-UE. Pour cela, la Commission européenne a créé un fond de 1,5 milliards € sur la période 2025-2027.

Agence européenne et fonds européen de Défense : vers l’autonomie stratégique ?
De son côté, l’Agence européenne de défense (AED) dessine les contours d’une autonomie stratégique européenne articulée autour de quatre programmes majeurs, décryptés par Le Point :
- La défense aérienne et antimissile : IAMD, Integrated Air Missile Defense
Une capacité cruciale pour protéger les infrastructures critiques européennes, les populations civiles et les forces militaires contre une gamme de plus en plus complexe de menaces aériennes (balistiques, missiles de croisière et drones).
- La guerre électronique
Avec un retard certain, les axes prioritaires portent sur les systèmes de brouillage, les systèmes de guerre électronique portables et les plateformes de renseignement électromagnétique, véritable impératif de souveraineté, permettant la perturbation des communications et des capteurs ennemis tout en protégeant les forces amies de la détection et des interférences pour assurer ainsi la domination informationnelle et la sauvegarde de la sécurité nationale.
- Les munitions téléguidées
Les drones kamikazes ayant démontré leur efficacité en Ukraine, les États-membres explorent les possibilités d’acquisition et de développement conjoints avec ces munitions offrant « une flexibilité opérationnelle » précieuse en combinant « collecte de renseignements et frappes de précision ».
- Les futurs navires de combat : European Combat Vessel (ECV)
La prochaine génération de navires de combat de surface, à l’horizon 2040, débute avec une plateforme flexible et modulaire capable de s’adapter aux besoins nationaux et d’intégrer des systèmes avancés au fil du temps, un défi industriel majeur alors que deux États membres – France et Allemagne – concentrent encore 80 % des dépenses de recherche et technologie de défense.
Face à ces enjeux, le Fonds européen de défense (FED) prévoit une augmentation substantielle de son soutien, avec des dépenses collaboratives en recherche devant atteindre plus de 600 millions d’euros en 2026. Une montée en puissance indispensable pour transformer ces quatre piliers en réalisations concrètes.
Enfin, promis par la présidente Ursula von der Leyen pour son second mandat, le Livre blanc sur l’avenir de la défense européenne est attendu pour le 19 mars prochain, afin notamment d’identifier les besoins en matière de défense.
Une approche des risques portée par un pays exemplaire en terme de dépenses militaires
Alors que sur le papier la somme des budgets militaires des États-membres de l’UE pourrait atteindre 284 milliards d’euros en 2025, soit le troisième budget derrière ceux des Etats-Unis et de la Chine, la réalité des dynamiques européennes en termes de défense tire plutôt vers le modèle polonais. Ce dernier peut compter sur une approche holistique, porté par un pays exemplaire en termes de dépenses militaires tandis que le couple franco-allemand, déjà souvent divisé sur les questions de défense, se trouve aujourd’hui en difficulté pour des raisons de politiques intérieures. Cela donnera-t-il plus de poids à la Pologne dans les prochains mois ? Qu’en est-il des défis de la prochaine présidence au second semestre 2025, portée par le Danemark, membre lui aussi exemplaire de l’OTAN, déjà menacé par le second mandat quasi-impérial de Donald Trump, qui menace sa souveraineté au Groenland ?
Michaël MALHERBE, Secrétaire général de « Atelier Europe »
(31/01/25)
Le site du think tank « Atelier Europe »