
La « question locale » traverse régulièrement les débats publics, et la crise sanitaire l’a mise en perspective. Des courants de pensées, parfois très opposés (comme les écologistes et les « nationalistes » du RN), investissent sur le « localisme », sur des « identités » particulières qui seraient insuffisamment reconnues et autonomes. Juriste et politologue, notamment Maître de conférences en Droit public à l’Université Paris II Panthéon-Assas, Benjamin Morel analyse ce que peut masquer l’affichage « localiste » et pointe certains risques de séparatisme de tendances qui s’opposent à l’historique et à la réalité d’aujourd’hui de l’unité républicaine française.
-La Revue Civique : Nous observons, depuis plusieurs années, une tendance, à la fois politique et de société, revendiquant une appartenance locale pouvant devenir prioritaire sur d’autres appartenances. Des courants apparemment aussi opposés que le courant environnementaliste et d’extrême droite la plus traditionnaliste peuvent ainsi se retrouver dans une promotion militante du « localisme ». Il y a bien sûr, en motivations affichées, de très bonnes intentions, celle de la proximité. Mais des formes extrêmes d’ »identitarisme » local ne peuvent-elles pas conduire, in fine, à une forme de séparatisme ?
-Benjamin MOREL: Le fait de mettre en valeur une production locale pour des raisons économiques et écologiques n’est en soi pas une mauvaise idée. Comme vous le notez bien, le souci vient de l’instrumentalisation qui est faite de ces idées par des groupes identitaires. Il s’agit là d’un mouvement qui est en fait assez ancien. À la fin du XIXe siècle, les transformations liées à la révolution industrielle ont conduit une partie des notables locaux et des courants réactionnaires à rêver d’un retour à des identités réifiées, idéalisées et en réalité assez éloignée des traditions locales réelles. En Bretagne, par exemple, on va mettre en avant une langue bretonne débarrassée de tous ses apports latins plutôt que le Gallo (dérivé du latin et parlé par l’immense majorité). Le caractère celtique est vu à la fois comme incarnant une Europe des origines et le rejet des références gréco-latines mises en avant par la République. Dans le sillon de Maurras et Barrès, il s’agissait de revenir sur les acquis de la Révolution de 1789 en opposant un autre récit national, celui d’un « pays réel » fondé sur des provinces aux identités éternelles et immuables dont l’unité entre elles reposerait sur l’allégeance à une monarchie restaurée.
Après le discrédit de l’entre-deux-guerres et de l’Occupation, les mouvements régionalistes identitaires ont repris de l’influence à partir des années 80.
Ces mouvements vont se radicaliser durant l’entre-deux-guerres, rompant avec l’idée d’une restauration monarchique. Il s’agissait alors d’opposer une vision clairement séparatiste, inspirée et parfois financée par l’Allemagne. La langue bretonne enseignée et diffusée est ainsi une construction militante du début du XXe siècle dont l’unité a été imposée par décret des forces d’Occupation en 1941. Avec la Libération, ces mouvements ont été déconsidérés et mis en sommeil mais certains membres y ayant collaboré ont contribué à une rénovation en profondeur qui, tout en préservant les bases du vieux programme, lui ont donné sous couvert de décolonialisme des atours respectables. L’aspect essentiellement identitaire de ces mouvements les rend assez souples et opportunistes sur les autres aspects de leurs programmes. Ils ont ainsi pu participer aux luttes sociales avant d’investir la thématique écologiste.

A partir des années 1980, trois évolutions ont toutefois renforcé leur poids. D’abord, si ces mouvements reposent sur des bases militantes faibles, ces dernières sont fortement motivées, organisées et possèdent d’importants relais d’influence dans le monde de la culture, la presse régionale et l’Université. Ensuite, la décentralisation leur a donné localement de l’importance. La lisibilité des compétences des collectivités est faible. En difficulté pour apprécier les programmes et les bilans, les électeurs peuvent plus facilement se déterminer sur un logiciel strictement symbolique et identitaire. Enfin, les entreprises et le secteur du tourisme ont trouvé opportun de jouer sur « l’authentique ». Ils ont repris les clichés, assez simplistes, sur la culture locale élaborés au XIXème siècle et toujours portés par ces groupes.
Dans une logique de mise en visibilité de l’identité locale, quitte à en sacrifier la complexité réelle, ces groupes ont pu offrir aux entrepreneurs et aux politiques ce qu’Anne-Marie Thiesse nomme un « kit identitaire » clefs en main (drapeau, hymne, langue unifiée et expurgée des apports du français). Continuons avec la langue bretonne reconstituée. Elle ne permet pas de communiquer avec les bretonnants natifs. Elle s’est pourtant imposée, entraînant de facto la non-transmission par l’éducation des dialectes en Basse-Bretagne. En Haute-Bretagne, où l’on parlait Gallo (dans des villes comme Nantes ou Rennes, on n’a jamais parlé breton), elle est devenue un étendard identitaire face à une langue locale vue (comme trop latine) pour démontrer l’absolue hétérogénéité de la Bretagne à la France. Si son enseignement n’a pas permis, et sans doute a empêché de sauver les vraies langues de Bretagne, il est devenu un instrument majeur d’influence des idéologues nationalistes.
Ces mouvements sont donc passés de repoussoir au sortir de la guerre à source d’inspiration pour les acteurs publics et privés locaux à partir des années 1980. Le localisme cesse alors d’être la mise en valeur d’une production locale pour devenir la transmission d’une idéologie déguisée en culture. Ce logiciel était celui du Rassemblement national au temps de Jean-Marie le Pen qui assumait son héritage maurrassien (souvenez-vous des défilés de drapeaux régionaux lors du 1er mai). Certaines formations ethnorégionalistes sont d’ailleurs nées de scission du RN (par exemple Alsace d’abord ou la Ligue du Sud). Il semblerait que le parti souhaite aujourd’hui en revenir à cet héritage. Par ailleurs, l’électorat demeure le même. Élie Claustre a ainsi montré que l’électorat votant nationaliste en Corse votait RN aux présidentielles[1], et pour les mêmes raisons. Toutefois, le RN n’est plus le seul aujourd’hui sur ce créneau.
« Le risque séparatiste est réel car le logiciel en question porte l’idée d’une identité éternelle (…) Gouvernement comme oppositions ont une responsabilité collective pour prévenir nos Catalogne de demain. »
Le risque séparatiste est réel, car le logiciel en question porte l’idée d’une identité éternelle qui mérite d’être institutionnellement reconnue par des structures propres. Des chercheurs comme Emmanuele Massetti et Arian Schakel ont assez bien montré ce phénomène, qui se manifeste ailleurs en Europe[2]. Les partis politiques classiques se sentent menacés par la montée du localisme et du régionalisme. Ils reprennent alors les revendications des régionalistes en espérant les affaiblir. C’est ce qu’a fait le Labour en Écosse ou le PRG en Corse ; c’est ce que font LREM et LR en Bretagne ou en Alsace. Cela passe notamment par la revendication d’un statut particulier qui permet de consacrer institutionnellement l’exceptionnalité irréductible de la communauté régionale concernée. Loin de nuire aux régionalistes, un tel discours conduit en réalité à légitimer leurs revendications et à reconnaître qu’ils avaient raison.

Selon la dernière enquête IFOP, parue en janvier 2019, l’annonce de la création de la collectivité européenne d’Alsace a renforcé le potentiel électoral d’un mouvement nationaliste alsacien. Le SNP a évincé le Labour de son fief écossais comme les nationalistes ont relégué le PRG en Corse. On assiste alors à une diversification des formations nationalistes qui se substituent aux partis nationaux. Les autonomistes obtenant de l’État central que soient satisfaites leurs revendications, ils n’ont plus rien à proposer qu’un programme gestionnaire peu compatible avec le souffle lyrique du discours nationaliste. Ils sont alors supplantés par des formations séparatistes, ce qui entraîne une crise larvée au sein de l’État. L’obtention de sièges nombreux pour ces formations fragilise également la gouvernabilité des États comme le montre le cas de l’Espagne, de la Belgique ou du gouvernement May en Grande-Bretagne. Par ailleurs, le reste de la population se radicalise devant le risque d’explosion et la déconsidération de la communauté nationale par les régionalistes. Vox est d’abord une réponse au régionalisme catalan et le UKIP a largement joué sur la peur que le référendum écossais avait instillée d’une dissolution du Royaume-Uni dans une Europe des régions dans sa campagne pour le Brexit. Ce n’est donc pas seulement les régions concernées, mais tout le pays qui prend le risque de s’enfermer dans l’instabilité et la radicalité. Gouvernement comme oppositions ont une responsabilité collective pour prévenir nos Catalogne de demain.
« Depuis le début des années 90, on assiste à une décentralisation croissante des compétences mais à une recentralisation des conditions de leur exercice. »
-La République française est, constitutionnellement, « Une et indivisible ». La loi est commune, quels que soient les territoires concernés. C’est une force, pour les valeurs essentielles — républicaines — parfois mises à mal dans certains territoires. Au niveau du droit, aucune exception (contrairement à certains autres pays démocratiques, anglo-saxons par exemple) n’est possible légalement. Dans la pratique, on le sait, les choses sont différentes. Mais justement, est-ce que l’unité républicaine n’a pas aussi quelques défauts, quand il s’agirait, pour les administrations et certaines décisions, de pouvoir s’adapter aux situations particulières locales, par exemple dans le domaine sanitaire, ou économique et social ?
-Le discours sur ce sujet est extrêmement idéologique et politique. En réalité, le principe d’Egalité connaît des modulations dès lors que des usagers du service public sont mis devant des situations différentes ou pour des raisons d’intérêt général. La loi s’applique à tous, mais elle n’est pas aveugle aux différences de situation. La loi littorale et la loi montagne montrent par exemple que la spécificité objective de certains territoires peut faire l’objet de règles propres. Par ailleurs, les collectivités disposent d’une marge de manœuvre théoriquement importante, si tentée, et c’est en revanche un vrai problème, que la loi soit bien écrite et n’empiète pas trop sur leur domaine de compétence. Le vrai problème est aujourd’hui là. Les élus locaux se retrouvent devant des compétences théoriques sur lesquelles leur prise est faible. La loi est bavarde, les décrets d’application le sont encore plus. Or, ils ne peuvent agir qu’en complément et dans le cadre de ces sources normatives. Ajoutez à cela la crise des finances locales et vous avez la recette d’un malaise, et même d’une colère absolument légitime. Depuis le début des années 90, on assiste à une décentralisation croissante des compétences mais à une recentralisation des conditions de leur exercice.
La solution trouvée à cela est en revanche extrêmement problématique. Plutôt que de retenir la plume des ministères et des parlementaires, on choisit de revenir sur l’un des apports essentiels de la Révolution, l’Egalité des citoyens devant la loi. Attention, on ne parle pas ici d’une méchante mesure vexatoire concoctée dans une obscure officine jacobine… On parle de dispositions datant de la loi du 4 août dans une Constituante tenue par des partisans d’une monarchie constitutionnelle libérale. De même l’unité de l’indivisibilité du Royaume est votée par la Constituante, comme le cadre départemental. Le décret reconnaissant l’unité de l’indivisibilité de la République est voté à la quasi-unanimité par la Convention girondine. Cette unité, c’est d’abord celle de la loi.
L’idée du gouvernement serait de laisser les élus adapter la loi. Comme cela n’a pas été possible à la suite de l’échec de la révision constitutionnelle, le gouvernement propose qu’une expérimentation législative ne puisse être généralisée qu’à des collectivités volontaires. C’est en fait une des vieilles revendications des nationalistes corses. Cela pose de vrais problèmes car, malgré les garde-fous, cela rompt l’égalité des citoyens devant la loi sans autre justification que le volontarisme des collectivités. Cela est ensuite source d’importance complexité. Alors que la décentralisation est déjà difficile à comprendre, la répartition des compétences, et même les lois pourront être à présent différentes à la frontière de chaque commune. Enfin, et au risque de doucher leur enthousiasme, les élus locaux risquent d’être les premières victimes de dispositifs les fragilisant juridiquement. In fine seules les collectivités les plus riches pourront jouer pleinement le jeu de la différenciation. Vous faisiez référence aux exemples étrangers, c’est sur ce modèle-là que le Pays basque espagnol est devenu une collectivité prédatrice utilisant ses ressources pour accroître encore plus sa compétitivité et vider le tissu économique d’autres régions espagnoles.
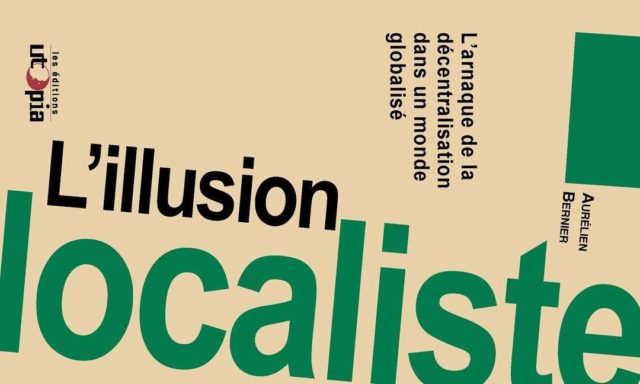
« Dans cette crise la France a accusé son centralisme, la Belgique, les États-Unis ou la Suisse leur fédéralisme… »
–Face à la pandémie planétaire, il semble qu’en Europe aucun « modèle » fonctionnel de l’État ne semble être assurément supérieur à un autre en termes d’efficacité. Au début de la crise Covid au printemps 2020, on a beaucoup critiqué, et sans doute avec arguments, les faiblesses de l’organisation administrative française, très centralisée et parfois très lourde. Puis, on a récemment vu que l’Allemagne, avec son système fédéral très souple, n’avait pas non plus de solution miracle, son administration sanitaire a même été débordée, la Chancellière devant prendre des mesures nationales particulièrement restrictives. Où devrait s’arrêter le curseur en France, entre sa tradition jacobine et les aspirations girondines ? Est-ce qu’une nouvelle réforme et étape de décentralisation vous paraît nécessaire ?
-Dans cette crise la France a accusé son centralisme, la Belgique, les États-Unis ou la Suisse leur fédéralisme… la Covid a conduit chacun à interroger son modèle face au choc et à en monter en épingle les défauts. Certains sont évidents. Prenons deux exemples issus d’États dits régionaux. Quand l’épidémie arrive en Italie et que le gouvernement central n’a pas les moyens d’imposer à la Lombardie de se confiner, car il n’existe pas de clause de suprématie (qu’avait pourtant proposée Mattéo Renzi dans sa réforme constitutionnelle en 2016), on est là devant une défaillance évidente du modèle italien. Tout aussi décentralisée, mais disposant de dispositifs adaptés, l’Espagne a pu imposer des mesures même quand le gouvernement catalan n’en voulait pas.
En France, une mesure de police administrative peut-être aggravée par une autorité locale (maire ou préfet), mais pas allégée dès lors que, prise au niveau national, il en va de l’intérêt général. Les maires prenant des arrêtés de réouverture des musées ou des commerces étaient donc, de manière évidente, dans l’illégalité. Ils le savaient, il s’agissait de mesures essentiellement politiques. En soi, le système normatif est, dans la gestion de crise, assez opérant. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas des problèmes. L’administration déconcentrée a été réduite à peau de chagrin rendant difficile le dialogue avec les élus. La fin du cumul des mandats a rendu difficile de faire remonter certains sujets. Enfin, l’existence d’une formation politique dominante au niveau national mais n’ayant aucune implantation locale conduit à une situation inédite d’affrontement entre local et national se superposant au clivage majorité opposition. Si cette situation devient structurelle, on peut assister à une succession de crises politiques interchamps, graves pour l’unité du pays.
À ce stade, la question n’est pas tant celle d’un nouvel acte de décentralisation. Les propositions de Territoires Unis sont d’ailleurs assez floues à ce sujet. On pourrait envisager de donner l’emploi aux régions, mais la plupart des compétences pouvant être décentralisées l’ont été, d’où la difficulté à mettre du contenu dans la loi 4D. La décentralisation des compétences est devenue idéologiquement une finalité en soi alors que l’enjeu est aujourd’hui plutôt son organisation avec une très faible lisibilité des compétences. Ce qui fait la différence entre nous et certains de nos voisins, c’est essentiellement l’Éducation et la Santé. L’idée de mettre fin à l’Éducation nationale sur laquelle s’est construite la République me semble peu opportune. Concernant la Santé, il faut comprendre qu’un système de santé décentralisé est aussi beaucoup plus inégalitaire.
L’une des raisons de la réussite de l’Allemagne durant la première vague est que soixante-dix pour cent des cas ont été recensés dans les trois Länder les plus riches. Plus que les compétences, c’est encore une fois la marge de manœuvre des collectivités dans l’exercice de ces dernières qu’il faut relever. Cela ne passe pas tant par de nouvelles lois de décentralisation que par une abstention du pouvoir national dans les domaines qui leur sont confiés. Cela passe ensuite par des moyens financiers suffisants en adéquation avec les charges transférées et une vraie autonomie fiscale compensée par une forte péréquation. Cela implique enfin un État qui joue son rôle en matière d’aménagement du territoire et d’ingénierie pour pallier les difficultés des territoires les plus faibles et redonner à leurs collectivités des marges de manœuvre.
Les initiatives du gouvernement sur ce sujet vont d’ailleurs dans le bon sens et Emmanuel Macron semble avoir bien compris de quoi il relevait lors du « grand débat » (de 2019). Il faudra du temps pour voir les fruits de tels efforts.
Benjamin MOREL, Maître de conférences en droit public à l’Université Paris II Panthéon-Assas, docteur en Science politique à l’ENS Paris-Saclay.
[1]https://lvsl.fr/fn-au-plus-haut-et-regionalisme-en-expansion-le-nouveau-visage-de-la-corse/
[2]Emanuele MASSETTI et Arjan H SCHAKEL, « Decentralisation Reforms and Regionalist Parties’ Strength: Accommodation, Empowerment or Both? », Political Studies, 2017, n ° 65, vol.2, pp.432–451 ; voir aussi Dawn BRANCATI, « The Origins and Strengths of Regional Parties », British Journal of Political Science n ° 38, vol.1, 2008, pp. 135–159.










