
Philosophe, spécialiste de René Descartes et essayiste, Nicolas Grimaldi a publié « Le Crépuscule de la Démocratie » (Éditions Grasset) où il se pose la question de savoir si notre démocratie moderne ne serait pas devenue une réalité trop fragile, et trop éloignée de ses propres principes, pour être confiée aux manipulateurs qui prétendent l’incarner. Extraits
———————————-
Quant au corps social (…) quels que puissent être son amertume et son ressentiment d’avoir été dupé, que peut-il faire que patienter pendant cinq ans ? Aussi attend-il à chaque fois les prochaines élections comme l’occasion d’une revanche. De quelque scrutin qu’il s’agisse, la majorité parlementaire les perdra. De là, vient cette perpétuelle alternance qui n’amène quelque parti au pouvoir que pour y préparer, dans une atmosphère de débâcle, l’imminent retour de celui auquel il avait succédé. S’ensuivent six traits caractéristiques de la vie politique contemporaine, et qui m’en paraissent autant de pathologies.
Le premier est une constante inflammation du corps social. Comme s’il souffrait de quelque gale qui l’irrite sans cesse, il supporte aussi peu tout remède que l’absence de remède. Rien ne lui paraît plus indispensable que de profondes réformes, sans pouvoir néanmoins supporter la moindre. En même temps que le démange un prurit du changement, il s’irrite comme d’une provocation du plus minime qu’on tente. De même que toutes les relations sociales se ressentent de cette acrimonie, toutes les initiatives politiques lui apparaissent comme autant de défis, d’agressions ou de provocations. Aussi beaucoup de gouvernements pressentent-ils ne rien pouvoir faire de mieux que de ne rien faire.
« Une défiance généralisée
de chacun à l’égard de tous »
Consécutif à cette perpétuelle déception, le deuxième symptôme qui caractérise la société contemporaine est une défiance généralisée de chacun à l’égard de tous, de tous les groupes entre eux, et de tous envers tous les gouvernements. Car toute société suppose entre tous ses membres la convention tacite d’un pacte social selon lequel chacun s’engage à rendre le service que les autres en attendent, et à en recevoir le concours correspondant à leur fonction. Autant la Révolution de 1789 a-t-elle pu s’ensuivre du sentiment généralisé que l’aristocratie ne jouait plus son rôle et que le pacte était donc rompu, autant ce même sentiment s’est-il perpétué sous tous les régimes qui l’ont suivie. Nous vivons depuis dans un sentiment de crise latente et de guerre civile larvée.
S’ensuit un troisième trait fort symptomatique de la société française depuis qu’elle se persuade de vivre en démocratie : c’est que ceux qui s’en prétendent les représentants ne la représentent pas. Et en effet, que représente la majorité parlementaire lorsque la plus grande partie du corps social s’en est tellement désolidarisée qu’elle la désavoue à toute occasion ? Cette majorité d’occasion ne se prévaut-elle pas alors pour gouverner d’une confiance qu’elle n’a plus ? N’abuse-t-elle pas d’une délégation qui lui avait été consentie mais que ses mandataires voudraient lui avoir retirée ? En se drapant dans sa légalité, n’essaie-t-elle pas de cacher ce simple fait quelque peu indécent de n’avoir plus de légitimité ? On peut s’en réconforter en rappelant que c’est le jeu démocratique. Mais peut-on arguer de « la règle du jeu » sans devoir convenir qu’il s’agit d’un jeu, et que chacun y feint donc par conventi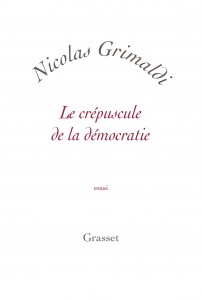 on de tenir pour réel ce qui n’a pas ou qui n’a plus la moindre réalité ? (…)
on de tenir pour réel ce qui n’a pas ou qui n’a plus la moindre réalité ? (…)
De là vient un quatrième trait de ces démocraties qu’un oxymore fait nommer parlementaires. Peut-être est-ce à la fois le plus caractéristique et le plus préoccupant. Car s’en répand à travers tout le corps social le sentiment diffus qu’autant de liberté qu’elle garantisse, la démocratie n’en est pas moins une supercherie. Chaque élection entretient l’illusion pour chaque citoyen de pouvoir changer quelque chose. Mais quelque choix qu’il fasse, la déception est la même. Quelques promesses qu’aient faites les candidats, il leur suffit en effet d’être élu pour se découvrir empêchés de les tenir par les contraintes mêmes de la réalité. Une seule chose, toutefois, est pire en démocratie que les promesses non tenues, c’est lorsqu’il arrive qu’elles le soient[1]. Le corps social découvre alors avec stupeur avoir lui-même cautionné ce qu’il subit avec horreur. Ce qu’il voudrait n’avoir jamais vu, c’est lui qui l’a choisi. Il a donné, en votant, un aveugle consentement à tout le contraire de ce qu’il espérait. Le processus juridique de l’élection se trouve être alors un piège : sans doute le piège a-t-il été tendu par d’autres, mais personne ne l’y a poussé, c’est lui qui s’y est tout librement jeté (…)
« On veut donner la parole au peuple
pour qu’il ne s’en empare violemment »
S’ensuit un cinquième caractère de ces régimes équivoques. Parce qu’on y aspire sans cesse au changement sans pouvoir rien changer, s’y est insinué et subrepticement diffusé le sentiment qu’on n’y peut changer la moindre chose si l’on ne commence par tout changer. Une sorte de prurit révolutionnaire ne cesse donc de hanter ces régimes qui se voudraient réformateurs, mais que le souci des prochaines élections empêche de jamais rien réformer, par crainte de les perdre. Tel est l’étau dans lequel se débattent en France tous les régimes depuis la Monarchie de Juillet. On veut donner la parole au peuple pour qu’il ne s’en empare violemment, tout en redoutant les conséquences de son vote si on le laissait librement s’exprimer. (…)
S’en trouve ainsi décrit le sixième trait du régime politique sous lequel nous vivons : comme il y a des amours haineux dont les partenaires ne peuvent se séparer quoiqu’ils ne rêvent que de séparation, ainsi n’éprouvons-nous à son égard qu’une confiance soupçonneuse, quelque méprisante compassion, une sorte de consentement dépité, qui nous retienne d’en changer quoiqu’il n’y ait rien dont on ne sente davantage la nécessité. Le paradoxe de ce système est en effet d’être envié par tous ceux qui ne l’ont pas, et méprisé par tous ceux qui n’ont d’autre choix que de s’y conformer ou de s’abstenir. Y a-t-il d’ailleurs plus incontestable preuve de ce mépris que le taux des abstentions lors des principales consultations électorales ? (…)
Nicolas GRIMALDI
Auteur de « Le crépuscule de la démocratie » (Grasset)
► Lire le texte de Brice Teinturier « La trappe à défiance »
►Lire « Des solutions pour la démocratie de demain », François Miquet-Marty
►Baromètre 2014 de la « Défiance » pour le CEVIPOF
[1] Cf. E. Renan, La Crise de 1871, 2e partie, in Histoire et parole, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1984, p. 622 : « La majorité numérique peut vouloir l’injustice, l’immoralité ; elle peut vouloir détruire son histoire, et alors la souveraineté numérique est la pire des erreurs. » L’histoire qui a suivi, durant tout le XXe siècle, n’a-t-elle pas tragiquement ratifié le jugement de Renan ? Combien de régimes parlementaires n’avons-nous vus se faire très démocratiquement les fourriers de la dictature qui les a supprimés ! Rien n’est aussi symptomatique d’une démocratie parlementaire comme cette tentation suicidaire qu’elle couve à petit bruit.










