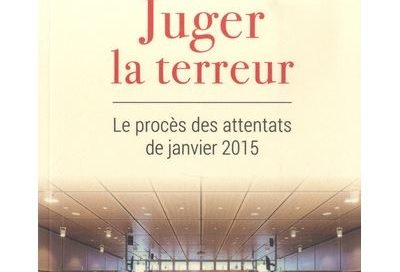
Smaïn Laacher est professeur de sociologie. Il est actuellement Président du conseil scientifique de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), membre du conseil scientifique de l’Institut convergences migrations (Collège de France), membre du comité de pilotage de le plateforme internationale de recherche sur le racisme et l’antisémitisme (Ecole Pratique des Hautes Etudes et Fondation Maison des sciences de l’Homme). Ces dernières publications sont « Le fait migratoire et les sept péchés capitaux » (éditions de l’Aube, 2022). « .Juger la terreur. Le procès des attentats de janvier 2015 » (éd de l’Aube, 2022). « Crise du débat démocratique. Doit-on limiter la liberté d’expression ? » (sous la direction de Smaïn Laacher, éditions Hermann, 2022). Pour La Revue civique, il s’entretient ici avec l’historien Marc Knobel.
-La Revue Civique: Smaïn Laacher, vous êtes sociologue, professeur de sociologie à l’Université de Strasbourg et vous venez de publier aux éditions de l’Aube un récit poignant, terrifiant également, mais aussi une analyse remarquable qui draine une multitude de sujets « Juger la terreur. Le procès des attentats de 2015. » Vous avez donc suivi toutes les audiences qui ont eu lieu, à la suite des attentats contre Charlie Hebdo, l’attaque de Montrouge et l’hyper cacher. Justement, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez voulu « suivre » ce procès ?
– Smaïn Laacher : Pour plusieurs raisons. La première, c’est que ce procès était le premier et d’une très grande importance politique en matière de terrorisme. Pour la première fois, la justice avait à examiner et à se prononcer sur un acte de violence politique fondée sur une justification religieuse, celle d’un Islam intégraliste ayant pour seul but la terreur et une supposée vengeance. La seconde raison, par familiarité avec la justice, le langage du droit, et la protection des persécutés (j’ai été de 1998 à 2014 Juge assesseur représentant le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à la Cour nationale du droit d’asile), ce procès ne pouvait pas ne pas susciter chez moi un intérêt sociologique et un puissant désir de comprendre notre époque au travers d’une justice en acte dont l’une des missions est de comprendre ce qu’il s’est passé, comment cela s’est passé et pourquoi cela s’est passé ainsi et pas autrement. En un mot, ce procès, pour moi, en disait long sur notre époque.

« Chez les terroristes, les musulmans intégristes, nous sommes dans la caricature meurtrière ».
–Pour écrire ce livre, quelle a été votre méthodologie ? Comment avez-vous travaillé ?
-Je n’ai pas utilisé de méthode précise comme je le fais d’habitude au cours de mes enquêtes. Je me suis d’abord laissé porter, lors des premières séances, par les situations, les échanges, les rituels, les controverses parfois de techniques juridiques, parfois philosophiques, etc. Puis, j’ai essayé d’articuler deux perspectives de mise en ordre du monde : le journalisme et sa pratique de l’urgence et de la construction de l’événement ; et la sociologie, en privilégiant une « branche » particulière de cette discipline, celle de l’interactionnisme symbolique (je pense ici Erving Goffman, Howard Becker, Anselm Strauss) ; mais sans oublier une sociologie souplement structuraliste, car l’événement se déroulait dans une institution mais aussi en dehors – souvenons-nous des attentats qui ont eu lieu lors du procès. Mais je dois préciser la chose suivante, en matière de méthodologie. J’ai été d’abord et avant tout, lors de ce procès, extrêmement attentif au « rebut », c’est-à-dire à ce que l’on a sous les yeux mais que l’on ne voit pas.
–Vous écrivez que ce procès dégagerait quelques aspects fondamentaux sur les conceptions que nous avions du vivre ensemble. Que voulez-vous dire ? Accessoirement, ce procès est-il un baromètre des tourments de notre époque ?
-Sans aucun doute. L’institution judiciaire, au travers de sa Cour d’assise spécialement composée, a été saisie par des enjeux qui ont directement à voir avec l’organisation d’une société démocratique dans laquelle le droit, le savoir et le pouvoir sont « désintriqués ». Cet aspect est fondamental. Car c’est exactement la figure antithétique qui a cours chez tous les terroristes quel que soit leur régime argumentatif. Chez les musulmans intégristes, nous sommes dans la caricature meurtrière : non seulement le temporel et le spirituel ne sont pas, et ne doivent pas être distingués (ce qui offre, soit-dit en passant, quelques ressemblances structurales et idéologiques avec les logiques totalitaristes) mais aussi, conséquence logique, le droit, le savoir et le pouvoir doivent être étroitement intriqués. Le seul moyen d’y arriver, c’est bien évidemment la terreur de masse. Autrement dit, l’enfer sur Terre. Et donc « vivre ensemble », en tout cas avec eux, est absolument impossible puisque nous avons affaire à des groupes habitants, si je puis dire, des mondes clos et qui ne peuvent prétendre à l’existence pleine et entière que si d’autres mondes et d’autres altérités sont rayés du monde.
–Vous plantez le décor, le palais, les rites, vous observez avec minutie les avocats, les magistrats, les témoins, les accusés, les gendarmes et les policiers, les victimes. Comme si vous constituiez une photographie d’ensemble, comme s’il s’agissait d’un tableau. Vous ajoutez à cet ensemble complexe, les duels symboliques, les affrontements, le langage procédural. En quoi, est-ce important ?
-Je suis sociologue et mon métier est d’observer et de comprendre. Et, à la vérité, c’est bien plus qu’un métier au sens professionnel et juridique ; c’est une passion, non pas au sens premier et religieux de « souffrance », mais au sens moderne d’une inclination irrépressible vers la connaissance ; se saisir des causes, avoir une perception la plus claire possible des conséquences, aller au plus près des pratiques pour accéder à leur sens et au sens qu’en donnent les personnes, etc. Pendant 54 jours, tous les jours j’accédais à une scène où se déployait un jeu d’acteurs (avec scène et coulisses) complexe et, c’est très important de le mentionner, dans une institution qui détermine profondément les actions (tactiques et stratégiques) de toutes les parties impliquées dans et par ce procès. On ne comprend comment « fonctionne » la justice en pareil cas que si l’on tient ensemble et dialectiquement le « micro » et le « macro » : les interactions et la structure dans laquelle elles se déroulent et prennent sens.
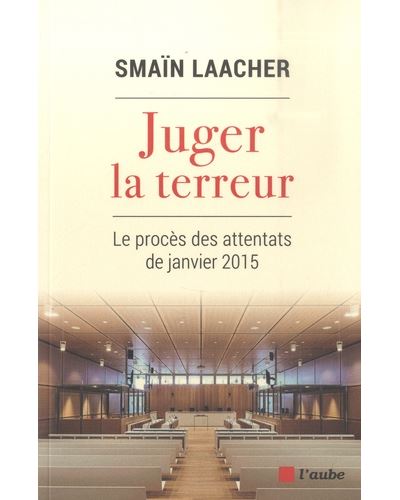
« S’efforcer de comprendre l’accomplissement de la justice des hommes ».
–Lors de ce procès, vous racontez que tous les visages étaient masqués. Par exemple, le masque du président Régis de Jorna, ne cessait de glisser sur son visage… Qu’est-ce que cela dit ?
-Le port (ou non) du masque, au début du procès, fut l’objet d’une controverse intéressante. La question posée était : un accusé peut-il être jugé masqué ? Je rappelle, pour mémoire, qu’à partir du XIII siècle une figure de la mythologie grecque, Thémis, apparaît sous les traits d’une femme aux yeux bandés. Cet « aveuglement » signifie l’impartialité, l’indifférence aux inégalités de conditions et de statuts. La Cour a tranché très vite. Pour des raisons sanitaires et aussi parce que le procès devait aller jusqu’à son terme (autrement dit se terminer à la fin du mois de novembre), tout le monde, du Président aux témoins, devait porter un masque. La Cour d’assise ne devait pas se transformer en « cluster ». Au début, ce fut difficile pour beaucoup mais très vite on s’est habitué à porter le masque et la controverse s’est très vite éteinte.
–Vous constatez que l’on retrouve certaines constantes chez les accusés. Lesquelles ? Vous écrivez même qu’il s’agit d’un « monde fait d’embrouilles et de carambouilles. » Qu’est-ce que ce procès, et les récits qui ont eu lieu ou ont été faits par les accusés eux-mêmes, disent sur leur inhumanité ?
-Je pense qu’il faut être prudent lorsqu’on parle d’inhumanité. C’est vrai pour certains accusés ; on ne peut pas le dire pour tous, mis à part deux ou trois accusés, d’authentiques brutes et complices. Par ailleurs, il n’y avait aucun idéologue parmi eux, contrairement à certains accusés des attentats du 13 novembre. Si on peut parler, à juste titre, d’inhumanité, c’est à propos des frères Kouachi et d’Amedy Coulibaly. Je me suis efforcé, et je ne suis pas le seul (ce fut le cas de certaines personnes des parties civiles), d’entendre chacun des accusés sans les confondre ; c’est cela aussi s’efforcer de comprendre l’accomplissement de la justice des hommes. Et n’est-ce pas cela qu’accomplit la justice quand elle s’efforce de rendre la justice et de rendre justice : ne pas se laisser envahir par la violence contre ceux qui n’ont que haine pour autrui ; compatir avec les victimes tout en ne se rendant pas aveugle aux différences réelles qui existaient entre les accusés dans l’implication du crime et du délit : Michel Catino n’est pas Ali Riza Polat, Amar Ramdani n’est pas Miguel Martinez (ce sont quelques-uns des accusés).
–Quels rapports les accusés ont-ils entretenu avec la religion ? Quelle conversion ? Quelle compréhension de l’Islam et de quel Islam s’agit-il ?
-Le rapport à la religion est un rapport « bricolé », sans culture, ni savoir. Ils ont rencontré la religion, ou ce qu’ils pensent être le texte sacré, dans la cité ou en prison. Ce sont là deux espaces de production de croyants approximatifs ; autrement dit, de dévots profondément incultes. Pour ce qui est de la mosquée, elle est d’abord et avant tout un lieu de socialisation post-conversion. En réalité, et j’en suis aujourd’hui convaincu, c’est pour moi plus qu’une hypothèse, c’est une conviction fondée sur ma familiarité pratique à ces univers : même ceux qui sont « nés » musulmans dans une famille musulmane se sont « convertis » à l’islam ou a quelque chose qui lui ressemble. Si j’emprunte au latin classique sa définition (convertere), convertir veut dire : « tourner, faire retourner, changer », et le latin chrétien nous indique que convertir signifie : « ramener à de meilleurs sentiments, remettre sur la bonne voie ». On peut, muni de cette large et très intéressante définition, dire que c’est exactement cela qui s’est passé pour les accusés. Ces derniers ont tardivement rencontré la religion et (d’abord) ses interdits relativement tardivement mais aussi (et surtout), la rédemption était pour eux la procédure la plus simple et la plus accessible pour accéder à « de meilleurs sentiments ».

« Je me disais qu’il fallait continuer à penser, que l’émotion devait coûte que coûte céder la place au sentiment qui, lui, avait partie liée au travail de la pensée »
–Vous consacrez un chapitre entier pour parler de l’émotion que suscite ce procès. Comment se traduit-elle ?
-J’ai vu, lors de certains récits de victimes directes des attentats, des personnes sortir de la salle d’audience en pleurs, s’adressant à d’autres, à peu près dans le même état, en leur disant que c’était trop « horrible », « insupportable », qu’on ne pouvait plus écouter tellement c’était douloureux. Je n’étais pas à l’abri de cette colère conjuguée à une douleur muette. Je n’ai pu, moi-même, échapper à cette « vague » d’émotion en écoutant quelques témoignages de parties civiles. Cela a provoqué chez moi un état affectif bref mais très intense, que l’on appelle l’émotion, que je ne confonds pas avec le sentiment. C’est vrai, j’étais profondément ému, comme beaucoup, mais je me suis efforcé de passer d’un état d’émotion (le corps qui trahit l’extrême malaise) à celui d’un effort pour faire place au sentiment, c’est-à-dire à une conscience plus ou moins claire que j’avais des choses, de la situation et des enjeux. Il me fallait résister ; je me disais qu’il fallait continuer à penser, que l’émotion devait coûte que coûte céder la place au sentiment qui, lui, avait partie liée au travail de la pensée dans son effort d’assembler et d’ordonner aussi rigoureusement que possible ce qui se déroulait sous mes yeux. Et je me suis dit au fond de moi-même que c’était pour la mémoire.
–Les trois attentats sont dissociables dans le temps et l’espace. Quelles différences existent-ils entre les uns et les autres ? Nous supposons que les audiences les plus importantes portaient sur Charlie hebdo. Dissocie-t-on plus particulièrement ceux de Montrouge et de l’hyper cacher ? Intéressent-ils moins la presse ?
-Charlie Hebdo et l’hyper-cacher ont produit la même attention et la même intensité émotionnelle. Les témoins et les victimes venus dire leur tragédie ont bouleversé la Cour ; et j’ai même vu des policiers très émus. Il est vrai que l’assassinat de Clarissa Jean-Philippe par Coulibaly a moins mobilisé la Cour et les médias. Mais dans les trois cas, et c’est cela qu’il est important de retenir, les assassins ont explicitement visé la liberté de conscience et de création, la figure (fantasmée) du juif et l’uniforme du policier. Et j’irai même plus loin : dans les trois cas, l’antisémitisme était explicite et revendiqué.
–Le dixième chapitre de votre livre est intitulé « Le Juif et le mécréant. » Qu’est-ce que ce cela dit de l’antisémitisme ? Vous évoquez ce « permis de tuer » du Juif. Comment se comportent à cet égard les accusés, plus précisément, lors des audiences qui ont été consacrées à l’hyper cacher?
-Les accusés sont quasiment restés muets tout au long du procès sur leur antisémitisme réel ou supposé. Ceux qui l’étaient réellement et qui politiquement ne s’en cachaient pas étaient morts, le 7 et le 9 janvier 2015. La défense des accusés pouvait se résumer ainsi : on se connaissait (la majorité des accusés connaissait les terroristes, surtout Amédy Coulibaly) mais on ne savait pas que les armes et l’argent allaient servir à un attentat. Ils reconnaissaient que c’étaient des truands de seconde zone mais pas des terroristes d’envergure et ils voulaient être condamnés pour les délits qu’ils avaient commis mais pas pour complicité ou participation à une activité terroriste ; ce qui aurait, bien évidemment, impliqué un aveu de racisme et d’antisémitisme.

« A plusieurs reprises, les victimes et leurs proches ont demandé (aux médias) qu’on les « oublie » et que leur douleur n’avait pas à être « partagée » sans pudeur par le monde entier ».
–Un encadré surprend dans votre huitième chapitre, il est intitulé « le harcèlement médiatique ». Quel regard portez-vous sur la manière dont les médias ont couvert ces différentes audiences ?
-Nombreux ont été les « survivants » (les victimes qui avaient survécus aux attentats ; c’est ainsi qu’ils souhaitaient qu’on les qualifie) ou les témoins (les parents ou les proches des « survivants ») qui se sont exprimés sur l’attitude des médias (journaux, radios et télévision) qui avaient eu, lors des attentats et après, une attitude indécente, particulièrement les journalistes des chaînes d’info en continu. Il y avait, mélangées dans la même réprobation, deux choses à leur égard. Tout d’abord, leur harcèlement continu, quotidien, auprès des « survivants » dès le lendemain des attentats pour un « témoignage » ou une « interview exclusive ». Des témoins racontaient que des journalistes faisaient le « pied de grue » devant leur domicile pour arracher un mot, une photo, etc. D’autre part, l’obsession, chaque année en janvier, de revenir sur le drame en montrant les mêmes photos, en citant les mêmes noms. Et tout cela en oubliant qu’à plusieurs reprises, les victimes et leurs proches ont demandé qu’on les « oublie » et que leur douleur n’avait pas à être « partagée » sans pudeur par le monde entier. Certains médias ont respecté cette demande ; d’autres non.
–Vous racontez qu’à un moment, la Cour s’apprête à diffuser deux vidéos liées à la revendication de l’attentat contre Charlie hebdo, par Al Qaïda. Qu’est-ce que cela dit de l’utilisation de la propagande et des réseaux sociaux par ces différentes officines terroristes ?
-Sans aucun doute, les réseaux sociaux, dans ce type de configuration, jouent un rôle certain. Toute la difficulté est de savoir quel rôle très précisément ils ont joué. Je pense qu’ils ont joué, mais de façon non décisive, un rôle d’« excitateurs » mais sans plus, probablement au début de l’engagement des trois assassins dans leur folie. Je remarque qu’il en était peu question lors de ce procès. Il a été surtout question de problèmes et d’énigmes autour de la téléphonie et des SMS.
En fait, pour qu’une telle opération soit menée jusqu’au bout, il est impératif d’être d’une absolue discrétion. Les frères Kouachi ont été, de ce point de vue, de parfaits modèles. Le réseau social ne produit pas l’acte. Et, dans le cas qui nous intéresse ici, il est même très secondaire. Il a fallu que les assassins se voient, se connaissent déjà depuis un certain temps, s’appuient sur des « compagnons » de route relativement fiables, dépendent les uns des autres (s’être connus dans la même cité ou en prison, ou avoir des liens familiaux, est très important), participent collectivement à l’achat d’armes, les transportent, etc. Et cela ne se fait pas avec les réseaux sociaux. Un téléphone, des SMS, un peu d’argent, des voitures, des armes, des vêtements de combat et… beaucoup de discrétion suffisent à mener une opération de cette envergure.
Propos recueillis par Marc KNOBEL (21/01/2022)











