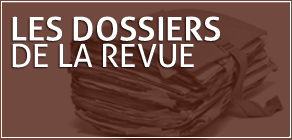Le Secrétaire général de « Confrontations Europe », Laurent Zylberberg, spécialiste de Finances publiques et président de l’Association européenne des investisseurs de long terme, est l’auteur de cet article très éclairant sur les moyens de financer la souveraineté européenne, « Du plan Juncker (2015) aux avoirs russes (2025) », qui contient une proposition précise, originale et judicieuse sur l’utilisation des intérêts relatifs aux avoirs russes. Proposition qui évite les difficultés juridiques que pose la confiscation de ces avoirs, mais qui rentabiliserait l’usage des intérêts produits. Il souligne: « alors que, sous nos yeux incrédules, nous voyons le monde basculer, nous savons qu’il y a urgence à faire très vite, ensemble, ce que nous n’imaginions pas de faire, seuls. » La Revue Civique a plaisir à republier et diffuser ce texte.
En 2015, Jean-Claude Juncker lançait le Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques. Ce Plan, plus connu sous le nom de Plan Juncker, reposait sur un double effet de levier. Dans un premier temps, 21 milliards d’euros, en provenance de la Commission Européenne et de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), étaient mobilisés pour servir de garantie. Dans un second temps, la BEI pouvait emprunter sur les marchés, grâce à cette garantie, un montant de 42 Milliards d’euros. Cela permettait de dégager un montant total de 315 Milliards d’euros pour financer, principalement, par de la dette et, plus marginalement, en fonds propres, des projets stratégiques majeurs. L’ensemble était très largement accompagné par les Banques et Institutions Financières Publiques Nationales (NPBIs) dans chacun des pays. En France, le Groupe Caisse des Dépôts et la BPI, jouèrent ce rôle et ont permis de déployer ce plan sur l’ensemble du territoire. Le succès du Plan Juncker fut tel que le montant total fut porté, ultérieurement, à 500 Milliards d’euros et pérennisé, moyennant quelques changements, sous la forme du programme InvestEU.
Alors que les Etats européens et la Commission européenne recherchent des sommes considérables pour financer nos industries de Défense et plus globalement l’ensemble de nos besoins en matière de souveraineté, le mécanisme du Plan Juncker est porteur de leçons utiles. Cela est d’autant plus pertinent que les événements de ces dernières années, de la crise Covid à l’invasion de l’Ukraine, nous ont montré qu’entre guerre hybride, conflits armés et faiblesses stratégiques, notre souveraineté était menacée de multiples façons. Pour y répondre, nous devons donc mobiliser toutes les ressources disponibles et, si possible, de la façon la plus efficace.
Les avoirs russes actuellement gelés doivent permettre une utilisation innovante de leurs intérêts, à intégrer comme une opportunité pour financer notre souveraineté et notre défense
Les ressources disponibles en Europe sont limitées alors que la moyenne européenne de Dette/PIB est supérieure à 80%, que les prélèvements obligatoires sont à leur plus haut niveau historique, aux alentours de 40% du PIB et que de nombreux pays, et non des moindres, sont lourdement endettés. Le Plan Juncker de 2015 et l’emprunt commun de 2020 montrent des pistes pour trouver une partie de ces financements lorsqu’on intègre les avoirs russes gelés comme un nouveau paramètre.

On le sait, la valeur totale des avoirs russes qui sont sous sanctions et donc gelés dans les banques européennes est supérieure à 300 Milliards €, dont plus de 200 Milliards directement de l’Etat russe. Cet ensemble produit, chaque année entre 2 et 3 Milliards d’intérêts dont, à ce jour, 1 milliard a été utilisé pour financer deux instruments de l’Union Européenne au profit de l’Ukraine. En droit international, il semble qu’il y ait un consensus pour reconnaitre que l’utilisation des intérêts ne pose pas de difficultés majeures. En tout état de cause, ces quelques milliards sont loin d’être suffisants pour répondre aux besoins des industries de défense qui se chiffrent en centaines de milliards pour la prochaine décennie.
Nous serions donc bien loin du compte si on oubliait que la finance ce n’est pas de la comptabilité et que la dynamique des chiffres est plus importante qu’une simple approche statique. En effet, c’est en dynamique qu’il faut regarder les financements et ceux-ci dépendent largement de la façon dont les liquidités sont utilisées. En clair, suivant que les montants sont utilisés pour des investissements, des prêts ou des garanties, ils produiront des effets différents. En effet, en utilisant tout ou partie des intérêts pour les transformer en fonds propres dédiés aux industries de défense qui ne peuvent pas lever des fonds sur les marchés, ce montant produira un effet de levier extrêmement puissant.
Le débat sur la confiscation des avoirs russes semble plus complexe et demande, sans doute, des décisions politiques fortes. Il existe, cependant, une possibilité d’utilisation qui pourrait être mise en œuvre relativement rapidement tout en reportant à plus tard les questions juridiques. En effet, ces sommes importantes sont en tout état de cause, immobilisées pour de nombreuses années. Il serait donc loisible de s’en servir comme garantie à plusieurs produits financiers destinés à financer la défense et la souveraineté européenne.
La nouvelle gestion de l’abondante épargne française et européenne
Alors que le débat en France et ailleurs, porte sur la création de livrets d’épargne ou d’emprunts dédiés, il faut se demander comment seront garantis ces nouveaux outils financiers afin que cela n’obère pas leurs coûts. Les NPBIs (Institutions financières nationales) qui gèrent de l’épargne, que l’on sait abondante au niveau européen, pourraient être garanties, en partie, par ces avoirs pour les sommes qui seraient dédiées à cet usage. Le coût de l’argent mobilisé qu’il s’agisse des fonds propres des NPBIs ou de l’épargne serait très largement diminué par cette garantie qui assurerait, par ailleurs une rentabilité certaine à ces produits. Comme une garantie n’est pas actionnée avant un certain temps, le montant des avoirs russes resterait inchangé et continuerait à produire des intérêts.
Reste une dernière question qui s’avère bien souvent déterminante dans le succès ou l’échec des mécanismes de financement : la gouvernance. Un des paradoxes du monde de la finance est que la robustesse financière compte souvent moins qu’une gouvernance crédible et solide. Dans le cas présent, il faut construire une gouvernance réunissant à la fois des acteurs financiers, on pense notamment à la BEI et aux NPBIs, et des représentants politiques des gouvernements et de la Commission européenne. Cet organe de gouvernance aurait pour mission de définir avec précision la thèse d’investissement et les domaines prioritaires en matière de crédit. Il reviendrait ensuite à un comité, dédié et indépendant, à l’image des comités d’investissement des sociétés de gestion, de prendre les décisions finales sur les projets.
Alors que sous nos yeux incrédules, nous voyons le monde basculer, nous savons qu’il y a urgence à faire très vite, ensemble, ce que nous n’imaginions pas de faire, seuls, en prenant le temps. Comme disent nos amis américains « let’s do it »
Laurent ZYLBERBERG, Secrétaire général de Confrontations-Europe
-Autre article de Laurent Zylberberg dans « Confrontations Europe » : « Entre faux prétextes et vrais problèmes, les industries de Défense et la lutte contre le réchauffement climatique »
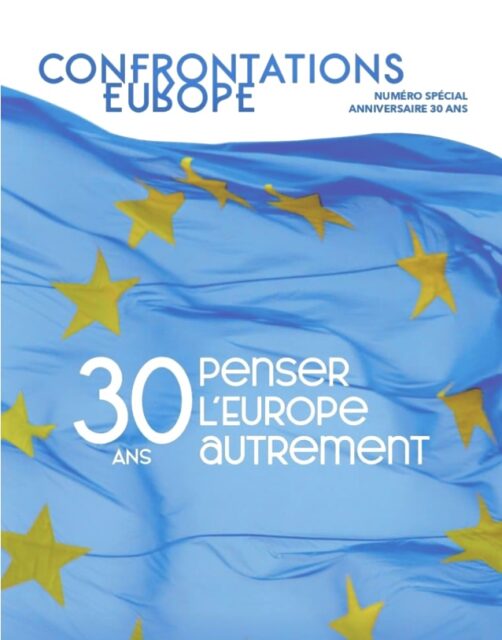
(05/04/27)