
Sociologue, essayiste et prospectiviste, François Miquet-Marty est président de l’institut d’études d’opinion Viavoice et du centre de prospective GCF (Global Center for the Future). Il répond ici aux questions de La Revue Civique sur les thèmes de son dernier livre « Les nouvelles fractures de l’humanité » (éd de L’Aube), ouvrage qui met en lumière les enjeux et les débats (d’avenir) sur le « transhumanisme ».
-La Revue Civique: au début de votre essai, vous dressez un panorama historique des grandes « fractures » du passé. Est-ce pour battre en brèche une illusion d’optique, qui revient parfois en boucle dans le débat public sur le thème « c’était mieux avant » ?
-La première idée de cet essai, Les nouvelles fractures de l’humanité, qui s’inscrit dans le sillage des travaux menés par le centre de prospective GCF (Global Center for the Future), consiste à relativiser une idée couramment répandue : la révolution anthropologique que constitue le transhumanisme, et plus largement les perspectives d’« humanité augmentée » qui se dessinent devant nous, consisteraient en une innovation radicale, une rupture non seulement par rapport au modèle « Homo Sapiens », mais encore par rapport à l’humanisme. D’une certaine manière, le transhumanisme serait pour l’essentiel un antihumanisme.
En réalité apparaît une genèse lointaine, très progressive, qui plaide en faveur d’une « augmentation », d’une « amélioration de l’humain », et qui s’enracine de manière en apparence paradoxale dans l’humanisme lui-même. Lorsque Montaigne évoque la « perfectibilité » de l’être humain, il en souligne en creux l’inachèvement, l’incomplétude. Ainsi faut-il distinguer deux registres : si l’humanisme proclame des finalités souvent bien éloignées de celles du transhumanisme, en revanche il pose un pré-requis, celui de l’imperfection de l’être humain, qui vaut encore aux yeux des transhumanistes.
Un long désenchantement existentiel
Par la suite, une large part de l’histoire jusqu’à la fin du vingtième siècle a consisté en un désenchantement existentiel. Tentative d’un homme « régénéré » selon le mot de Mona Ozouf sous la Révolution française, ambitions absolutistes des totalitarismes conduisant aux désastres que l’on connaît, « Homme sans Dieu » éprouvant l’absurde, déconstructivismes de la seconde moitié du vingtième siècle : le tournant de l’an 2000 fut celui d’une détresse existentielle absolue, et d’une interrogation sans fond sur la nature et les finalités de l’être humain.
Ce dont vous parlez maintenant, le déploiement du transhumanisme, constitue précisément l’une des réponses à cette détresse.
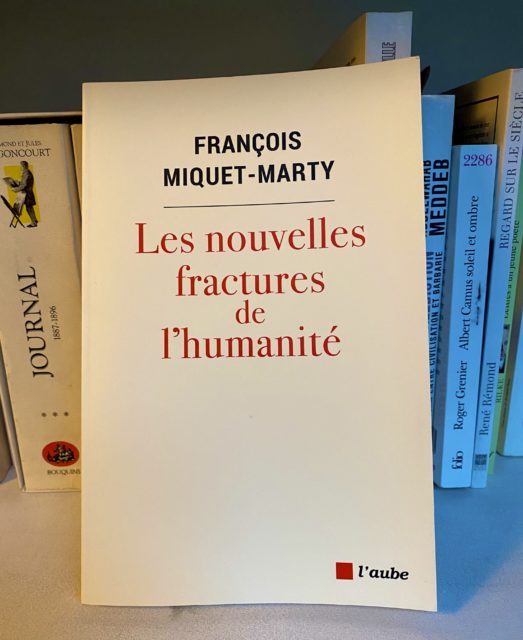
-Dans l’approche prospective de votre livre, vous évoquez les progrès de la science, les perspectives, pouvant inquiéter aussi, du transhumanisme et vous détaillez diverses nouvelles fractures pouvant menacer l’humanité. Quelles sont-elles principalement ?
-En effet, et vous touchez ici la thèse centrale du livre : le transhumanisme n’est pas le seul avenir de l’Homme. Dès aujourd’hui se met en place une pluralité de figures de l’être humain appelées à devenir de plus en plus concurrentes entre elles à l’avenir.
Je distingue sept figures :
- L’Homo Tech, celui précisément du transhumanisme ;
- L’Homo Digitalis, celui des avatars qui après-demain pourront être dotées d’intelligence artificielle ;
- L’Homo Natura, qui se pense en symbiose avec le vivant, qu’il soit animal ou végétal. C’est notamment la thèse du philosophe Emmanuele Coccia ;
- L’Homo Cultura, qui définit le fait d’être humain par une « âme » et une « culture » : Martha Nussbaum aux Etats-Unis déploie cette vision, pour partie inspirée du philosophe indien Tagore ;
- L’Homo Terra, défini par son terroir, selon une vision post-barrèsienne ;
- L’Homo Spiritus, qui définit l’humain par les spiritualités de toutes natures, monothéistes ou pas. Parmi mille références, la récente Commission pontificale chargée de répondre à la question « Qu’est-ce que l’Homme » conclut par les termes suivants : « la réalité de l’Homme n’est pas visible » ;
- L’Homo Integris, ou « bioconservateur », qui ne souffre aucune modification de sa physiologie actuelle.
Ce qui s’annonce sur l’ensemble de la planète est une diffraction et une mise en concurrence entre ces « types d’humains » qui, pour la plupart d’entre eux, sont incomptables : une « guerre des Hommes », et pas uniquement une « guerre des nations ».
-Une guerre meurtrière, imposée par une puissance autocratique et à prétention impériale, frappe depuis des mois un pays et les populations civiles à l’Est de notre Europe. Comment analysez-vous le fait que les démocraties européennes ont pu se bercer d’illusion en pensant que la guerre n’était possible que loin d’Europe, pour les autres ?
-En l’occurrence il s’agit d’une guerre au sens classique du terme, impériale pour reprendre le juste terme que vous utilisez.
L’illusion que vous évoquez, pour ne pas dire l’aveuglement, procède à mon sens de deux facteurs majeurs qui relèvent surtout des mentalités et des représentations collectives, et moins d’une prise en compte des rapports de forces et ambitions géopolitiques.
Le premier facteur, très simple, est que l’idée même de guerre était inconnue non seulement des générations les plus jeunes mais également d’une large partie des générations adultes. D’une certaine manière, la guerre en Europe ne faisait plus partie du domaine de l’envisageable. De telles perceptions sont fréquentes en prospective : imaginer des scénarios de rupture est extraordinairement difficile car la pente naturelle consiste à envisager, malgré tout, la reproduction de l’existant.
« La guerre est devenue par nature injustifiable, pour une large partie des opinions publiques occidentales »
En outre prévaut me semble-t-il un facteur plus profond : non seulement l’idée de guerre – et sa réalité – apparaissent inenvisageables, mais surtout ses finalités, ses raisons d’être, ses mobiles sont désormais tenus comme inconcevables, au sens premier du terme. Il ne s’agit pas de dire que les motivations de Vladimir Poutine sont difficiles à appréhender, entre volonté de puissance, réflexe obsidional justifié ou non, mobilisation de l’idée patriotique ou nationaliste censée fédérer, vision combative héritée de la « Grande Russie » ou du KGB : il s’agit de considérer que la guerre est devenue par nature injustifiable, pour une large partie des opinions publiques occidentales. Il n’existe ni « guerre juste », ni « guerre sainte », ni « héroïsme patriotique » : la guerre par nature est devenue injustifiable. Mourir pour Marioupol, plus encore que « mourir pour Dantzig », n’a plus aucun sens pour la plupart des Occidentaux.
Ces deux facteurs rendent compte, à mon sens, de l’occultation de l’hypothèse de la « guerre poutinienne » : cette guerre était inconcevable, et sa raison d’être plus encore.

-La France, vous le savez par les études d’opinion que vous analysez, est frappée d’un double syndrome, celui d’un pessimisme particulièrement prononcé pour tout ce qui concerne la vie publique et celui du « village gaulois », les Français refusant souvent de voir ce qui se passe autour d’eux en Europe, et encore plus dans le reste du monde. Comment ce double syndrome peut-il être, même partiellement, corrigé à l’avenir ?
-Ce double syndrome est très juste et passionnant. Loin d’être anecdotique, il signe à mon sens l’épuisement de l’idéal républicain universaliste.
Depuis la Révolution française, la France est ce pays qui, de manière très singulière, a entendu inventer à la fois son avenir et sa relation au monde par une vision politique, par un récit politique. La Troisième République a consacré l’apothéose de ce modèle, d’idéal républicain universaliste, diffusé par l’école et qui assignait à la fois un nouveau téléologisme et une prétention – pour ne pas dire une proclamation – de supériorité universelle.
Le « rêve » universaliste républicain s’est brisé sur les mouvements de décolonisation et une vision élitaire
Ce « rêve », consacré en avenir commun et fierté collective, s’est brisé sur les mouvements de décolonisation, sur l’érosion progressive des performances et de l’influence françaises dans le monde et sur la vision élitaire (dominatrice, masculine, diplômée et blanche) qu’il avait laissé perdurer au mépris des « minorités ».
Aujourd’hui, et de manière croissante depuis une trentaine d’années, la France souffre de cet orphelinat, de la perte de cette matrice fondatrice de son identité indissolublement politique, historiciste, patriotique et universelle.
La « solution » pour reprendre votre question, ne saurait être univoque ni s’imposer de manière unilatérale. Elle sera le fruit des mutations, de société et idéologiques, et elle devrait être le cœur des débats politiques et notamment en vue des présidentielles successives. Tour à tour, peuvent être imaginés le ralliement à un nouveau récit politique fédérateur, totalement réinventé sur les cendres du précédent ; ou des récits communautaires ou affinitaires concurrents – c’est selon moi le scénario le plus vraisemblable et qui se déploie aujourd’hui – ; ou enfin une multiplication de récits personnels, à hauteur de vies humaines et de replis sur des valeurs et aspirations singulières.
Cet enjeu, consistant à « refaire société », est le fil rouge de mes livres. Il anime aussi en permanence les travaux des équipes de l’institut d’études d’opinion Viavoice et du centre de prospective GCF : « relier ce qui se dissocie ».
(24/11/22)










