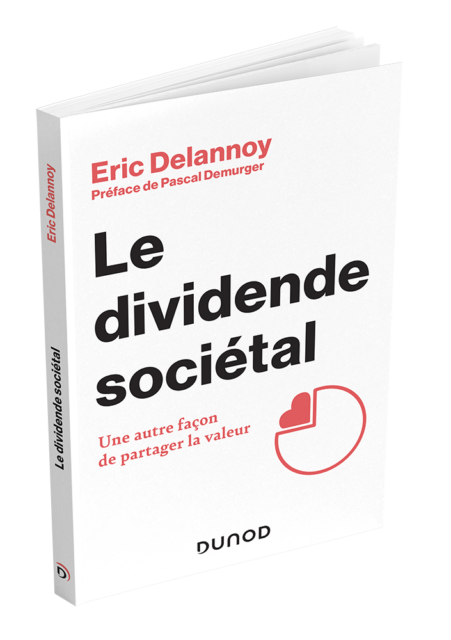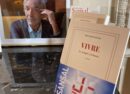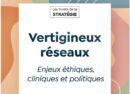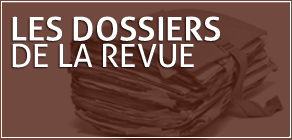Chef d’entreprise – il est le Président fondateur de Tenzing – et économiste, Eric Delannoy sort le livre « Le dividende sociétal. Une autre façon de partager la valeur », édité chez Dunod. Dans un monde et une époque de brutalité, il affirme cette conviction dans cet entretien à la Revue Civique: « Être à contre-courant de ce qui risque de nous envoyer collectivement dans le mur, c’est faire œuvre de résistance; et proposer des outils comme le dividende sociétal prépare la résilience de long terme des entreprises ». Dans son argumentaire, alors que la brutalité trumpienne lance sa guerre commerciale, il ajoute: la France et l’Europe doivent « être la géographie » d’une conception innovante et humaniste de l’entreprise, d’une certaine idée du libéralisme économique qui sait concilier performance financière et partage de valeurs sociétales. Entretien.
-La Revue Civique : Vous mettez en avant des expériences réelles, des pratiques d’entreprises capables de « concilier performance et sens ». N’êtes-vous pas à contre-courant de la brutalité de l’époque en évoquant un capitalisme à visage humain, les vertus d’entreprises sociétalement engagées ?
-Eric DELANNOY: Justement, c’est parce que nous entrons dans une ère de la brutalité où la force risque de supplanter le droit et l’égoïsme servir de boussole que nous devons réaffirmer les vertus de la coopération et le sens du collectif. Être à contre-courant de ce qui risque de nous envoyer collectivement dans le mur c’est faire œuvre de résistance et proposer des outils, comme le dividende sociétal, prépare la résilience de long terme des entreprises. Il y a un an, mon livre pouvait intéresser parce qu’il fait un état des lieux du rôle politique de l’entreprise, au sens engagement dans la Cité, rôle politique qui faisait de plus en plus consensus compte tenu de la responsabilité reconnue des entreprises dans le dérèglement climatique et les fractures sociales. C’était donc une question de degré dans la mise en œuvre.
Aujourd’hui et encore plus demain, mon livre pourra intéresser par l’espoir qu’il véhicule. La résistance à la brutalité consiste à rappeler que, malgré tout, de nombreuses entreprises sont prêtes à faire évoluer l’imaginaire capitaliste plutôt que de succomber aux sirènes d’un jusqu’au boutisme de court terme. Le livre propose un ensemble d’idées concrètes, issues de pratiques réelles, pour consacrer plus de moyens dans des projets d’intérêt général à mesure de la volonté d’implication de chaque dirigeant. Loin de l’ère de la brutalité qui éradique les gardes fous d’un avenir possible, ce livre témoigne du fait que l’ère de l’espoir pour une société plus juste et plus durable existe déjà. L’Europe doit en être sa géographie. Elle ne doit rien céder à la force et lui opposer une puissance de coopération soutenue par l’évidence de la réalité telle qu’elle s’annonce pour l’humanité entière. Ce livre démontre qu’il existe un chemin qui, sans renoncer aux logiques de compétitivité, valorise les coalitions, l’innovation compatible avec les enjeux de durabilité et la responsabilité vis-à-vis de la collectivité. La coopération sur des projets qui améliorent le bien commun et la défense des droits humains ne sont pas une faiblesse. Elles construisent un avenir viable pour le plus grand nombre alors que la brutalité, par sa puissance destructrice, ne porte que le projet de ceux qui la propagent et finira avec eux sur un champ de ruines.

La demande de Trump aux entreprises (de stopper les actions de préventions des discriminations) contrevient à la loi française et européenne
-La Revue Civique: On constate que les aspirations sociétales, par exemple l’égalité femmes-hommes, sont percutées aujourd’hui par les consignes du pouvoir américain, l’équipe de Trump en vient non seulement à vouloir stopper les dispositifs de lutte contre les discriminations aux Etats-Unis mais à faire pression sur les entreprises françaises et européennes pour qu’elles cessent leurs actions en matière d’inclusion. Quelles réponses le monde des dirigeants d’entreprises, selon vous, peut et doit opposer à cette forme d’ingérence ?
-Eric DELANNOY : La réponse adéquate n’est pas si évidente que cela n’y paraît. S’y soumettre c’est reconnaître la victoire de la force sur le droit et montrer qu’il n’y a aucune limite à la pression que peut mettre le plus fort sur le reste du monde. Que se passerait-il si, au lieu de se focaliser sur le sujet des discriminations, cette ingérence souhaitait remettre en cause les politiques de décarbonation ? D’un autre côté, balayer cette tentative d’ingérence d’un revers de main indigné c’est potentiellement fragiliser l’équilibre financier d’une entreprise, d’un secteur, voire d’une économie. La réponse se doit donc d’être construite sur la base d’une appréciation à froid de ce qui est réellement demandé.
Rappelons tout d’abord qu’une partie de la demande de Trump contrevient à la loi française et européenne. La loi Rixain de 2021 par exemple oblige à l’amélioration de la parité femme-homme dans les instances dirigeantes des entreprises et fixe même des seuils. Il faut ensuite comprendre la demande réelle qui se cache derrière cette pression : la lutte obsessionnelle de l’administration Trump contre le wokisme. Or, les entreprises françaises ne sont pas à proprement parler « woke », comme cela peut être le cas de certaines aux Etats-Unis, le cadre culturel étant profondément différent. Tout au plus, les plus internationales d’entre elles usent et quelquefois abusent d’un marketing des valeurs qui s’appuie sur la survalorisation des communautarismes dans une logique très individualiste. Cela ne touche pas à leur culture profonde et s’avère facilement réversible somme toute comme toute pratique marketing. L’engagement des entreprises est très loin de se limiter à des politiques de D&I marketées. En résumé, la loi française et européenne nous impose de lutter contre les discriminations. Ce n’est donc pas négociable. Mais les politiques d’inclusion et d’égalité des chances doivent s’affranchir d’une démarche marketing et continuer à se centrer sur ce qu’elles doivent être dans notre référentiel culturel : l’accessibilité à l’emploi, la mobilité et le développement des compétences pour tous. Enfin, il me semble clé à la fois de refuser d’entrer dans un système de justification sans pour autant renoncer à conquérir le marché américain, ce qui suppose donc d’adapter le discours de manière opportuniste sans renoncer à ses valeurs profondes.
Pour l’entreprise moderne, il s’agit de « répartir la valeur non pas selon le diptyque capital-travail mais selon un triptyque capital-travail-écosystème »
-La Revue Civique : Vous précisez dans votre livre les étapes permettant aux entreprises d’associer efficacement des pratiques de « partage de la valeur » (sociétale) à une rentabilité (financière) durable. Est-ce que ce schéma de développement n’est pas réservé aux plus grosses entreprises, aux grands groupes, les petites et moyennes entreprises étant contraintes par des impératifs de court terme, en matière de rentabilité ?
-Eric DELANNOY: Je suis convaincu que la taille de l’entreprise n’est pas du tout le sujet. Je dirige une PME de 70 salariés créée il y a 9 ans et qui a mis en place le dividende sociétal l’année suivante de sa création. Nous avons reversé plus de 1 million d’euros à une quinzaine d’associations œuvrant en faveur de l’égalité des chances. Le seul prérequis, comme vous le notez, consiste à adapter la capacité de partage de la valeur de l’entreprise à sa rentabilité financière. Or, le pourcentage de PME et ETI bénéficiaires est à peu près identique au pourcentage de grandes entreprises bénéficiaires, soit les trois quarts, ce ratio étant assez stable dans le temps. Le frein le plus important à l’augmentation du dividende sociétal est la structure actionnariale car sa mise en place revient à faire accepter par la gouvernance de non plus répartir la valeur selon le diptyque capital-travail mais selon un triptyque capital-travail-écosystème. Une partie de ce qui aurait du revenir aux actionnaires (rémunération du capital) retourne vers la société et l’environnement, ce que nous appelons les parties prenantes silencieuses.
Il convient donc de rendre le partage de la valeur désirable pour les actionnaires en insistant plus sur ce qu’ils ont à gagner à long terme que sur ce qu’ils perdent à court terme : accepter de gagner moins pour gagner plus longtemps. C’est la raison pour laquelle les premières entreprises à assumer de mettre le partage de la valeur à un niveau stratégique via le dividende sociétal sont des entreprises mutualistes qui n’ont pas d’actionnaires ou des entreprises qui ont fait le choix de faire porter une partie de leur actions par des structures non lucratives de type fondation actionnaire, ou encore des entreprises dirigées par leurs actionnaires fondateurs qui font entrer leurs propres convictions dans la décision. Les autres restent à convaincre en tablant à la fois sur la tendance au mimétisme, la force des coopérations et les incitations des pouvoirs publics.
(09/04/2025)
-Le livre d’Eric Delannoy aux éditions DUNOD